« C’est tout notre système économique qui est organisé pour stimuler l’importation »

Mouloud Hedir est économiste, spécialiste du commerce extérieur. Il revient, dans cet entretien, sur les dernières mesures prises et analyse la difficulté d’atteindre l’objectif de réduction des importations. Entretien.
Les résultats du commerce extérieur pour les six premiers mois de l’année révèlent une stabilité presque complète des importations depuis près d’une année. Les importations algériennes ont-elles atteint un plancher incompressible après avoir baissé assez sensiblement en 2015 et 2016 ?Ce système des licences d’importation a été motivé au départ par la nécessité de corriger le déficit élevé de la balance des paiements. Alors, établir toutes ces listes de produits soumis à restrictions pour arriver en bout de course à peine à stabiliser le niveau des importations laisse dubitatif quant aux véritables ressorts de cette politique publique. Comme de plus les listes elles-mêmes sont sans cesse mouvantes et que l’évolution du taux de change est incertaine, il est tout à fait malaisé de faire des projections sur le niveau du déficit commercial à fin 2017.
Pour le reste, nous ne sommes plus dans la vieille économie administrée et il n’y a aucun plancher d’importation qui soit incompressible. Le gouvernement dispose d’instruments puissants pour réguler l’importation, mais ce sont les entreprises qui prennent les décisions en matière d’importation. Bien sûr, le niveau des importations est de nature à affecter la croissance économique. Et en bonne logique, c’est de perspectives de croissance que nous devrions discuter, pas de baisse d’importation ou de niveau des réserves de change.
Les récentes instructions données aux banques en matière de suspensions des domiciliations pour certains produits alimentaires (fruits secs, confitures, mayonnaise, chocolat, etc.) sont elles de nature à modifier la tendance à la stabilisation des importations ? S’agit-il pour vous d’un constat d’échec de la politique des licences d’importation mise en œuvre depuis plus d’une année ?Raisonnablement, le rôle des banques serait d’accompagner le développement des entreprises et d’être les vecteurs de leur modernisation et de leur intégration réussie au marché mondial, et non de se transformer en gestionnaires des restrictions commerciales aux dépens de leur clientèle. C’est bien la peine d’accueillir sur notre territoire de grandes banques internationales si c’est pour en faire des clones bureaucratiques.
S’agissant de ces dernières décisions de suspension des domiciliations de quelques produits, leur effet sur la balance commerciale est tout à fait minime. Et dans ce cas de figure, on se demande bien pourquoi, au lieu d’interdire l’importation de produits qu’il considère apparemment comme superflus, le gouvernement ne procède pas par l’instauration de taxes fiscales. Non seulement il perturbe l’exercice d’activités légalement établies, mais il se prive de ressources précieuses en ces temps de disette budgétaire.
Quelles sont selon vous les principales limites de cette démarche administrative de gestion du commerce extérieur ?Cette démarche pêche d’abord par son mauvais calibrage et par le manque de clarté quant à ses objectifs. S’il s’agit de répondre au déficit de la balance des paiements, les choix de produits à contingenter ne sont pas à la hauteur voulue. S’il s’agit de protéger la production nationale, comme on a pu l’entendre quelquefois, la liste des produits n’est pas la plus appropriée et, de toute façon, il faudra au préalable lever l’hypothèque des engagements internationaux souscrits notamment avec le partenaire européen. S’il s’agit de s’attaquer à des importations considérées comme superflues, pourquoi ne pas les décourager par une fiscalité idoine ? En fin de compte, le fait que la liste des produits à contingenter s’élargit au jour le jour laisse planer un sentiment d’improvisation qui n’aide pas à donner de la visibilité à la politique suivie.
S’il veut être efficace et ne pas se noyer dans les procédures bureaucratiques, le gouvernement serait plus avisé de mettre rapidement sur la table un programme d’actions complet, avec des objectifs chiffrés, un échéancier de mise en œuvre et un dispositif d’évaluation périodique.
La baisse significative des importations enregistrée en 2015 et 2016 dans un contexte de dévaluation du dinar ne suggère-t-elle pas que la gestion du taux de change serait un moyen plus efficace et suffisant pour réduire les importations ?La surévaluation du dinar algérien est un phénomène structurel que de nombreux analystes, FMI compris, pointent du doigt depuis longtemps, bien avant le retournement des prix pétroliers de 2014. Après 2014, et malgré les ajustements opérés sur le taux de change, ce phénomène s’est accentué lourdement et explique pour une bonne part l’étendue abyssale du déficit de la balance des paiements observé en 2015 et 2016.
Dans ces conditions, la poursuite de l’ajustement du taux de change est une mesure nécessaire mais, comme elle est susceptible d’affecter sensiblement tous les agents économiques (le budget de l’État, les marchés des entreprises, le pouvoir d’achat des ménages), elle ne peut être opérée que de manière graduelle. Surtout, elle doit être accompagnée de réformes de fond touchant au régime des subventions, à la régulation des échanges extérieurs, à la politique d’investissement, à la modernisation du système financier et bancaire, etc. Comme toutes ces réformes n’ont pas été opérées en phase d’abondance de ressources, elles doivent l’être aujourd’hui dans un contexte plus contraint et sans doute aussi plus douloureux.
On comprend facilement que les autorités hésitent à emprunter ce chemin et qu’elles préfèrent revenir à la vieille recette des restrictions aux importations. Elles n’ignorent pas que cette solution, qui permet seulement de gagner du temps, conduit fatalement à une impasse. En d’autres termes, l’agenda politique n’est toujours pas calé sur le mode des réformes pourtant urgentes de l’économie.
Gestion administrative ou gestion économique du commerce extérieur ? Quelle conclusion vous suggère, dans ce domaine, la séquence des dernières années marquée d’abord par une explosion des importations puis aujourd’hui par ce qui s’apparente à une fuite en avant dans une forme de contrôle administratif et bureaucratique ?Pour l’heure, nous n’avons toujours pas ouvert la page de ce qui pourrait préfigurer une saine approche de la politique commerciale externe de notre pays. Nous en sommes toujours à ce débat stérile sur la manière de consommer les recettes en devises tirées de nos exportations d’hydrocarbures. Ces recettes sont encore substantielles mais, à mesure de leur tarissement, elles mettent à nu l’ampleur de nos gaspillages et toutes les tares de notre économie.
Il nous faut prendre conscience que c’est tout notre système économique qui est organisé pour stimuler l’importation. La surévaluation de notre monnaie est une prime permanente offerte aux importateurs. Les subventions généreuses accordées à la consommation de nombreux produits importés (par ailleurs souvent subventionnés à la production dans les pays fournisseurs) condamnent toute possibilité de développer leur production en Algérie. Notre système financier lui-même tire plus de bénéfices des activités d’importation et est très peu incité à soutenir la production locale. Si l’on ajoute à cela la baisse tendancielle des protections tarifaires (et dans certains cas leur démantèlement pur et simple), la porosité de notre système de défenses commerciales, la carence des services aux entreprises et, enfin, toute cette faune bureaucratique qui parasite notre climat des affaires, on comprend à quel point notre discours en faveur du développement de la production nationale est en total décalage avec la réalité économique. Et pour clôturer le tout, nous continuons de dresser des obstacles face à de potentiels investisseurs étrangers, là-même où nous ouvrons toutes grandes les portes aux simples exportateurs.
Dans ces conditions, on s’explique parfaitement l’indigence absolue dans laquelle se trouve plongé notre appareil de production. Un simple chiffre pour l’illustrer : la valeur totale de la production industrielle algérienne (hors hydrocarbures) est estimée à quelques 9 Mds de $US (environ 5% du PIB). Songeons que ce montant est inférieur aux seules exportations de produits industriels de la Tunisie (11 Mds de $US) ou du Maroc (14 Mds de $US), pour ne retenir que l’exemple de ces deux pays voisins.
On comprend après cela à quel point notre débat sur les licences d’importation est hors du temps.
- CRB - PAC : Une place de dauphin en jeu pour le Chabab
- Mikhail Bogdanov reçu par Tebboune : L’Algérie et la Russie consolident leurs relations
- Après les viandes et les poissons : Y-a-t-il une spéculation sur les prix du café ?
- CSC - Le rêve grandissant des Sanafir en coupe : L’appétit vient en mangeant
- CSC - Le rêve grandissant des Sanafir en coupe : L’appétit vient en mangeant
- ESS : Prêts pour la JSS
- Suite à la riposte iranienne: La Malaisie appelle à une désescalade au Moyen-Orient
- Appel à participation au colloque sur les transformations du théâtre en Afrique à l’ère des médias
- Education nationale : Les orientations de Belabed pour le 3e trimestre
- Rumeurs sur une révision de l’allocation chômage: La Présidence dément
- USMA - Après sa brillante qualification pour les ¼ finale : Cap sur l’US Biskra
- ESS : L’Entente met le paquet pour Chetti et Draoui
Infos régionales

Autres sites
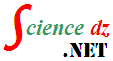
Le site des sciences en Algérie
Vous cherchez un emploi? Essayer la recherche d'emploi en Algérie
 Babalweb Annonces
Babalweb AnnoncesPetites annonces gratuites