Document. Les dessous des deux transitions difficiles auxquelles fait face l’Algérie révélés par l’International Crisis Group

L’Algérie fait face à deux transitions difficiles. La première, rendue nécessaire par la chute des prix du pétrole depuis le pic du début des années 2010, correspond à la sortie d’un modèle économique reposant principalement sur les revenus pétroliers et gaziers et sur d’importantes dépenses publiques. La seconde se rapporte à une succession présidentielle incertaine, avec un président, Abdelaziz Bouteflika, âgé de 81 ans et très affaibli par un accident vasculaire cérébral en 2013, qui arrivera au terme de son quatrième mandat de cinq ans en 2019.
Ces deux transitions sont liées : l’ère Bouteflika a coïncidé, jusqu’en 2014, avec une période d’augmentation continue des prix du pétrole qui a soutenu l’économie algérienne alors que le pays se relevait de la guerre civile des années 1990. Cette période a aussi vu naitre une nouvelle classe d’entrepreneurs qui a stimulé la croissance mais dont le poids politique croissant et la corruption rampante constituent un frein aux réformes. Pour préserver la relative stabilité de l’Algérie dans une région tourmentée, il sera crucial de réussir simultanément ces deux transitions.
Ce rapport montre pourquoi le modèle économique actuel n’est pas viable, une situation que les autorités reconnaissent ouvertement mais qu’elles peinent à corriger. Cette difficulté est courante dans les Etats « rentiers » – dont le budget annuel dépend excessivement des revenus pétroliers – confrontés à l’impératif de changement : la population, habituée au carburant et autres produits de base subventionnés, voit d’un mauvais œil la baisse des dépenses publiques. En Algérie, la tâche est rendue plus difficile par le lien tacite entre la prospérité économique et le processus de réconciliation nationale entrepris depuis l’arrivée au pouvoir de Bouteflika, en 1999. La conjoncture économique des années d’après-guerre civile, avec des prix du pétrole au beau fixe permettant à la fois des dépenses sociales et l’émergence d’une nouvelle élite économique, a contribué à éviter le retour de la violence. Les réformes sont freinées à la fois par les traumatismes persistants de la guerre civile – qui avait commencé comme un mouvement populaire appelant à des réformes politiques et économiques pour se terminer dans un bain de sang –, et par la capacité de groupes d’intérêts influents qui ont prospéré sous Bouteflika de bloquer tout changement politique qui risquerait de les affecter négativement.
Les soulèvements arabes de 2011 et leurs conséquences ont souligné la fragilité des modèles économiques et politiques qui existent dans la région.
Les soulèvements arabes de 2011 et leurs conséquences ont souligné la fragilité des modèles économiques et politiques qui existent dans la région. L’Algérie ne s’identifie pas à ces pays car elle a connu, et fini par surmonter, ses propres bouleversements politiques et sociaux majeurs dans les années 1980 et 1990. Conséquence de cette histoire et des traumatismes associés, le pays n’a pas connu de troubles significatifs en 2011. La classe au pouvoir, bien que souvent critiquée, conserve une légitimité historique qui découle de la guerre de libération nationale contre la France, ainsi que le soutien de la population, en partie du fait de l’absence d’alternatives claires. Pourtant, l’Algérie a de nombreux points communs avec ses voisins : une population très jeune, une économie réfractaire aux réformes qui tourne au ralenti, et une passation de pouvoir plus qu’incertaine à l’horizon. Le sentiment d’être à l’abri des tendances régionales ne devrait pas donner lieu à de la complaisance.
Ce rapport repose sur des recherches effectuées en Algérie en 2017 et 2018, y compris des entretiens menés avec des responsables gouvernementaux et politiques, des entrepreneurs, des membres de la société civile, des universitaires et des journalistes. Il s’intéresse aux façons de conjuguer la volonté actuelle d’éviter un choc socio-économique en pleine transition politique et la nécessité pour le pays de s’adapter à un environnement économique très volatile et de répondre aux attentes des Algériens au seuil de la prochaine décennie.
II.Un modèle économique à bout de souffle A.Une dépendance dangereuse aux réserves d’hydrocarbures qui s’épuisentL’Algérie est extrêmement dépendante des revenus des hydrocarbures. Le pétrole et le gaz représentaient 97 pour cent des exportations, deux tiers des revenus de l’Etat et un tiers du PIB en 2014. En des jours meilleurs, cette ressource a permis à l’Etat de dépenser sans compter pour acheter la loyauté des élites et la paix sociale. Les revenus du pétrole ont permis au gouvernement d’ignorer largement les demandes de participation citoyenne et de transparence. Et quand les bénéfices financiers tels que les généreuses subventions et la gratuité des logements se sont révélés insuffisants pour étouffer la grogne sociale, ces revenus ont permis aux services de sécurité d’acquérir les moyens coercitifs nécessaires pour la réprimer.
Mais l’économie de rente a ses défauts. Elle a rendu l’Etat complaisant, protégé un secteur privé dans lequel les marchés publics sont attribués sur la base des relations personnelles plutôt que du mérite ou de l’efficacité, et maintenu des industries non compétitives à l’échelle internationale. Cela a également favorisé un sentiment d’ayant droit au sein de la population. Ces différents facteurs ont fait de l’Algérie un pays vulnérable aux fluctuations mondiales des prix des marchandises, ce qui risque de transformer le déclin économique qui dure depuis 2014 en une crise de légitimité politique. Le manque d’efficacité dans le secteur énergétique entrave encore davantage une économie qui tourne au ralenti. Ainsi, tandis que sa production diminue, l’Algérie est devenue le seul membre de l’OPEP à pomper en-dessous du quota autorisé, malgré les efforts entrepris pour attirer de nouveaux investisseurs.
Les réserves énergétiques prouvées de l’Algérie s’amenuisent également. Le calendrier prévisionnel d’extraction – vingt ans pour le pétrole et quinze pour le gaz – indique que d’ici une ou deux générations et à moins de nouvelles découvertes significatives ou d’avancées technologiques majeures, les réserves pourraient être épuisées. En attendant, les effets de la baisse des investissements internationaux dans le secteur des hydrocarbures et du vieillissement des champs pétrolifères se font déjà sentir. En 2007, l’Algérie a exporté 85 milliards de mètres cubes (mmc) de gaz naturel ; en 2018, l’objectif d’exportation n’est plus fixé qu’à 50 mmc. En outre, la consommation nationale augmente, du fait de la croissance démographique et de l’évolution des modes de consommation. Une proportion croissante de la production reste dans le pays, ce qui diminue les exportations et, par conséquent, l’accès aux devises étrangères nécessaires à l’importation de marchandises.
L’Algérie redouble d’efforts pour augmenter sa production, y compris en employant des techniques controversées telles que la fracturation hydraulique. Tandis que l’ambivalence affichée concernant une participation étrangère accrue dans le secteur du pétrole et du gaz a bloqué à maintes reprises les réformes réglementaires, l’Etat pourrait se trouver dans l’obligation d’opter pour des solutions plus radicales, comme rendre l’investissement en Algérie plus attractif pour des multinationales capables d’améliorer le rendement des puits existants et de développer de nouvelles ressources telles que le gaz de schiste. Le projet du gouvernement d’augmenter la production de pétrole de 14 pour cent d’ici 2019 et d’investir des milliards dans l’exploration n’est pas réaliste, en partie à cause des interminables scandales de corruption qui paralysent la Sonatrach, l’entreprise pétrolière d’Etat ; ceux-ci sont généralement considérés comme le résultat d’un bras de fer entre les responsables politiques et les services de renseignement. Une gestion chaotique, marquée par la succession de quatre ministres de l’Energie et de six PDG de la Sonatrach depuis 2010, a affecté la stabilité du secteur pétrolier. Comme le souligne un analyste de l’industrie pétrolière :
Ce fut un double revers. Le scandale qui a entaché la Sonatrach et le ministère de l’Energie en 2010 a laissé tout le monde dans l’expectative. A cette période a succédé la chute des prix du pétrole en 2014. Or, avec cette dégringolade, même si les entreprises pétrolières se sentaient mieux armées pour faire face aux risques liés aux changements à leur tête et à l’environnement réglementaire, elles ne disposaient pas de la marge de manœuvre financière qui leur aurait permis de retourner en Algérie et de commencer à investir.
B.Le choc pétrolier de 2014Mi-2014, les prix du pétrole ont entamé une chute vertigineuse. Le baril, qui valait entre 80 et 110 dollars de 2011 à 2013, s’est négocié entre 40 et 60 dollars pendant presque toute la période 2015-2017. Depuis, l’Algérie a puisé dans ses 200 milliards de dollars de réserves de change pour maintenir son économie à flot, ce qui a souligné les faiblesses structurelles de son modèle économique. La chute du cours du pétrole a eu des conséquences désastreuses pour les caisses de l’Etat : en 2007, les recettes publiques s’élevaient à 74 milliards de dollars ; en 2017, elles étaient tombées à 24 milliards de dollars. Parallèlement, l’Algérie a triplé sa facture d’importation de carburant entre 2016 et 2017, pour atteindre un montant record de 2,5 milliards de dollars.
Bien que le prix du baril de pétrole se soit stabilisé entre 40 et 60 dollars en 2017 avant d’augmenter à nouveau en 2018, cela n’est pas nécessairement le signe d’une reprise durable. Quoi qu’il en soit, un cours du pétrole plus haut aurait pour seul effet de permettre aux autorités de gagner du temps avant de s’attaquer aux problèmes de fond. L’Etat ne peut plus se permettre d’ignorer ce que les économistes appellent le « syndrome hollandais » : une devise nationale surévaluée (en raison de la politique de la Banque centrale visant à maintenir un dinar algérien artificiellement fort) qui renchérit les exportations et les rend ainsi non compétitives. Cela aboutit à une diminution de la productivité industrielle hors secteur pétrolier, ce qui aggrave le chômage et rend l’économie fortement vulnérable aux fluctuations imprévisibles des prix des marchandises (par exemple du pétrole, des minéraux et des céréales).
Les gouvernements algériens successifs l’ont reconnu. Abdelmalek Sellal, Premier ministre entre 2012 et 2017, avait appelé en 2016 à mettre en place un « nouveau modèle économique » qui réduirait le rôle de l’Etat tout en consolidant celui du secteur privé et en limitant la dépendance aux revenus pétroliers et gaziers. Ses successeurs ont répété le même message. Ils se sont tous heurtés à la résistance de groupes d’intérêt économique influents et à l’inertie institutionnelle, qui les ont condamnés à renoncer à leurs projets de réforme.
Néanmoins, l’Algérie dispose encore d’une marge de manœuvre importante pour concevoir une nouvelle approche, principalement grâce à la faiblesse de sa dette extérieure, inférieure à 2 pour cent du PIB. Ses partenaires – en particulier les pays européens qui souhaitent pouvoir compter sur des Etats forts au sud de la Méditerranée, pour coopérer en matière de sécurité régionale et endiguer les flux de migrants et de réfugiés – sont prêts à apporter leur soutien. Les experts prévoient que les réserves de change, bien qu’elles s’amenuisent, pourront encore financer les dépenses publiques pour environ deux ans. Comme l’indique un expert au sein d’une institution financière internationale :
Le choc pétrolier a rendu plus manifeste le fait que des changements étaient nécessaires de toute urgence. La difficulté pour les autorités algériennes sera de trouver le bon rythme : si ces changements sont trop lents, l’ajustement pourrait être chaotique, et s’ils sont trop rapides, ils se heurteront la résistance de la population. Les autorités ont les moyens de placer le curseur au bon endroit ; reste à trouver cet endroit.
C.Quel programme de réforme ?Quand le cours du pétrole s’est effondré en juin 2014, l’Algérie disposait d’importantes réserves qui lui ont permis d’amortir le choc (178 milliards de dollars de devises étrangères et 37 milliards de dollars dans son Fonds de régulation des recettes [FRR], financé par les excédents budgétaires liés aux exportations d’hydrocarbures). Pourtant, au début de l’année 2018, il ne restait plus que 97,3 milliards de dollars de réserves, tandis que le gouvernement a épuisé le FRR en 2017 pour financer les déficits budgétaires successifs. Les autorités, persuadées que le cours du pétrole allait remonter, ont calculé le budget de 2017 sur la base d’un baril de pétrole à 70 dollars d’ici 2020 – un niveau atteint au premier trimestre de 2018, mais qui pourrait ne pas se maintenir.
Prudemment et sans grande cohérence, le gouvernement a reconnu la crise.Prudemment et sans grande cohérence, le gouvernement a reconnu la crise. Il a introduit de timides mesures d’austérité dans le budget 2016, en coupant de 9 pour cent les dépenses publiques. Début 2016, il a augmenté le prix du carburant subventionné. N’étant confronté à aucune opposition d’envergure, il a ensuite opté pour des mesures plus agressives, diminuant de 14 pour cent les dépenses publiques dans le budget 2017. Il a également pris d’autres mesures telles que l’introduction de restrictions à l’importation et l’autorisation d’une dépréciation contrôlée du dinar algérien. Le budget 2018, adopté en décembre 2017, prévoit de nouvelles coupes. A cela s’est ajouté le recours à l’assouplissement quantitatif – une création de monnaie par la Banque centrale à travers l’émission d’obligations d’Etat – pour stimuler l’économie.
Ces mesures comportaient de nombreux risques. Bien qu’encensées par certains, il reste à savoir si elles constituent une stratégie globale de réforme économique ou une réponse superficielle à une crise urgente. Les experts économiques et les institutions financières ont en particulier critiqué l’assouplissement quantitatif. Selon un économiste, la mesure ne fait que « jeter de l’huile sur le feu » de l’inflation et augmentera le coût de la vie, découragera les investissements directs étrangers et sapera probablement les efforts d’industrialisation. Un diplomate européen résume ces critiques en ces termes : « L’assouplissement quantitatif vise à gagner du temps, pas à mettre en œuvre des réformes. Cela augmente juste les liquidités, au risque de créer de l’inflation. »
Certains responsables affirment que le gouvernement a l’intention de rationaliser les dépenses publiques en révisant les programmes de subventions inefficaces et inutiles, d’augmenter les impôts pour la frange la plus riche de la population, de réduire et de formaliser l’économie informelle en rendant le secteur bancaire plus flexible et d’encourager la croissance du secteur industriel (qui représente actuellement moins de 5 pour cent du PIB). Experts et responsables politiques s’accordent à dire que la diversification de l’économie visant à réduire sa dépendance aux revenus pétroliers et gaziers, de préférence via l’augmentation d’autres types d’exportations, est indispensable, tout comme la réduction de la facture des importations. Les responsables débattent depuis des années des moyens de mettre en œuvre ces réformes majeures, mais sans résultat concret.
D.Les traumatismes du passéCette inaction s’explique notamment par le fait que le passage d’un socialisme d’Etat à un modèle plus proche d’une économie de marché de la fin des années 1980 au début des années 1990 est intimement lié, dans l’esprit des Algériens, à la violence de la décennie noire qui a suivi. Lorsque le cours du pétrole s’effondre en octobre 1985, les recettes tirées des exportations de gaz et de pétrole chutent de plus de 40 pour cent. S’ensuit une crise à plusieurs niveaux : les autorités abandonnent les programmes d’investissement et réduisent les programmes sociaux de grande ampleur. Les usines ferment, ce qui entraine une hausse du chômage et une chute de la productivité. Le gouvernement, persuadé que le cours du pétrole va remonter, puise alors dans les réserves de change et emprunte à l’extérieur pour financer les déficits budgétaires. Entre 1985 et 1988, le ratio du service de la dette fait plus que doubler, passant de 35 à 80 pour cent.
La crise économique et sociale qui a suivi la chute du cours du pétrole de 1985 a constitué le terreau des émeutes d’octobre 1988, lorsque des milliers de personnes sont descendues dans la rue pour manifester contre la hausse des prix, le chômage et les mesures d’austérité. Le pays n’avait pas connu d’émeutes de cette ampleur depuis son indépendance en 1962. Les manifestations ont commencé à Alger avant de s’étendre à d’autres régions. Le déploiement de l’armée pour mettre fin à l’agitation a suscité des affrontements qui ont fait 500 morts (principalement quand l’armée a tiré sur les manifestants) et plus d’un millier de blessés. Ces évènements ont précipité la fin du parti unique et abouti, en 1991, aux premières élections libres du pays, suivies d’un coup d’Etat militaire qui a conduit l’Algérie à la guerre civile pendant ce que l’on a appelé la décennie noire. Au sujet de cette période, un membre du conseil exécutif du Forum des chefs d’entreprise (FCE, un groupe d’intérêt des entrepreneurs) déclare : « Nous ne pouvons pas revenir à l’Algérie des années 1990, un pays ravagé par le terrorisme et où la population, en mal de perspectives d’avenir et de visibilité, rejoignait les rebelles ».
Le souvenir de la dépression économique qui a précédé et exacerbé la violence politique hante tous les décideurs politiques, y compris les réformateurs. La dernière expérience de libéralisation économique et de démocratisation politique en Algérie a conduit à une décennie de massacres fratricides. Aujourd’hui, les autorités ne font jamais publiquement référence aux liens entre la crise économique et les troubles politiques et sociaux qui s’en sont ensuivis. Mais ce vécu – en particulier la perte de souveraineté dans la gestion des réformes – les hante, à l’heure où elles tentent de ne pas reproduire les mêmes erreurs.
Depuis l’arrivée au pouvoir de Bouteflika en 1999, l’Algérie est parvenue à éviter qu’un tel scénario se répète. Ses trois premiers mandats ont représenté quinze années de prospérité croissante, au cours desquelles le pays s’est relevé d’un long conflit, retrouvant sécurité et stabilité. En appelant à la « concorde civile » lors de sa première élection en 1999, Bouteflika a offert aux Algériens un nouveau contrat social : oublier la « décennie noire » et les questions de responsabilité pour se concentrer sur le développement économique. Grâce à un cours du pétrole au beau fixe pendant près de deux décennies, il est parvenu progressivement à arracher en partie le pouvoir des mains d’une classe dirigeante très puissante – l’armée, le Département du renseignement et de la sécurité (DRS), et le Front national de libération (FLN, le parti unique historique jusqu’à 1989) – souvent appelée « le pouvoir ». Il lui a substitué une présidence dont la prééminence avait été érodée par les troubles des années 1980 et 1990, construisant un régime dans lequel les élites économiques ont petit à petit acquis l’influence jadis réservée aux officiers supérieurs de l’armée ou à d’autres membres de la classe dirigeante.
Les soulèvements arabes de 2011 ont constitué la première mise à l’épreuve de ce nouveau système. Le gouvernement n’a pas lésiné sur les dépenses publiques pour apaiser le mécontentement de la population. Cette politique de l’aumône, qui comprenait de généreuses subventions, des investissements dans les infrastructures et un ambitieux programme pour la gratuité du logement, a offert une sécurité économique à de nombreux Algériens en échange du maintien de la paix sociale. En 2011, le gouvernement a créé des milliers de nouveaux emplois, en particulier dans le secteur de la sécurité, et supervisé une augmentation de 330 pour cent par rapport à l’année précédente des crédits sans intérêt à destination des jeunes entrepreneurs, via l’Agence nationale de soutien à l’emploi des jeunes (ANSEJ). Dans un tel contexte, les inquiétudes de la population, relayées par les médias, concernant la corruption et les dépenses superflues n’ont pas eu une grande portée et l’Algérie est sortie largement indemne de cette période de bouleversements régionaux.
Au cours de son quatrième mandat, à partir de 2014, Bouteflika a consolidé sa nouvelle configuration politique (en particulier avec le démantèlement de la DRS). Mais cette période a également été marquée par une incertitude politique croissante (notamment concernant la santé du président et sa capacité à gouverner) et le retour de la fébrilité économique.
III.L’élaboration des politiques économiques A.L’art de la politique économiqueDans le système présidentiel algérien, le chef de l’Etat a le dernier mot sur la politique économique. Depuis 2014, un conseil consultatif chargé de la politique économique cherche à forger des compromis entre les trois institutions qui forment la Tripartite : l’Union générale des travailleurs algériens (UGTA), le Forum des chefs d’entreprise (FCE) et le conseil des ministres. En théorie, ce dispositif se veut inclusif et garant de stabilité puisqu’il réunit des ministres, une association de chefs d’entreprise qui a rapidement gagné en influence depuis 2014 et la confédération syndicale la plus puissante et historiquement la plus importante du pays. En pratique, la Tripartite est une structure pyramidale et fait de la loyauté à l’égard du gouvernement une condition sine qua non pour participer au débat économique. L’exclusion d’acteurs importants, tels que des syndicats autonomes ou des entrepreneurs dissidents, limite la portée du débat.
Sur la scène politique, l’UGTA comme le FCE se situent au centre : le FCE défend les intérêts des entreprises tout en reconnaissant les racines socialistes du pays ; l’UGTA défend les travailleurs tout en soutenant l’émergence d’un secteur privé fort et en exprimant l’idée, que l’on aurait plutôt tendance à attribuer aux entrepreneurs, selon laquelle trop de bureaucratie nuit à la création d’emplois et aux affaires en général. Ces deux organisations considèrent que la Tripartite constitue un cadre constructif de dialogue social et sont d’avis que l’entreprise privée est essentielle au développement économique. Un responsable de l’UGTA affirme : « Nous n’avons peut-être pas le même niveau de dialogue social que les Scandinaves, mais nous faisons de notre mieux pour éviter la violence. Chaque partie doit être à l’écoute et faire des propositions. Nous devons nous écouter mutuellement ». De même, un membre du conseil exécutif du FCE indique :
Nous ne disons rien contre les entreprises publiques, comme Air Algérie qui a 10 000 salariés au lieu de 3 500 …. Mais il faut renforcer le secteur privé, le rendre plus robuste et plus dynamique afin que le secteur public puisse progressivement disparaitre, sauf dans certains secteurs clés comme le gaz, le pétrole et les services d’utilité publique ».
Dans un environnement où la prise de décision reste très opaque, les dirigeants de l’UGTA et du FCE – respectivement Abdelmajid Sidi Said et Ali Haddad – jouissent d’une influence et d’un prestige importants du fait de leur proximité avec Saïd Bouteflika, le frère du président et l’un de ses principaux conseillers.
Si la Tripartite semble pouvoir faire la synthèse entre les perspectives discordantes des deux organisations en matière de politique économique, l’une plus à gauche et l’autre plus libérale, la prise de décision est erratique, quand elle n’est pas paralysée. La coordination est mauvaise au sein des institutions et entre celles-ci, et la politique peut changer de façon arbitraire. Au cours du quatrième mandat de Bouteflika, le taux de renouvellement du personnel au sein du gouvernement a atteint des sommets, en particulier au sein des ministères clés tels que l’énergie et l’industrie. Cela a semé la confusion concernant les priorités du pays, qui sont fixées par le Premier ministre mais peuvent ensuite être modifiées par décret présidentiel. L’opacité du processus de prise de décision et le manque de communication et de coopération au sein du gouvernement renforcent cette ambigüité : en général, faute de coordination entre eux, les ministères ne connaissent pas les projets et les approches des autres. Un spécialiste de la politique industrielle qui a travaillé avec le gouvernement déclare :
Le contexte politique n’est pas propice à la diversification de l’économie. Les organismes qui devraient travailler ensemble ne le font pas. J’ai posé des questions sur l’élaboration de la politique industrielle à chacun des ministères concernés : le ministère des Finances m’a répondu qu’il ne traitait pas de politique industrielle, le ministère de l’Industrie m’a renvoyé vers le ministère du Commerce et le ministère du Commerce m’a répondu qu’il ne s’occupait que des statistiques commerciales et non de l’élaboration de la politique, et qu’il fallait que je m’adresse au ministère des Finances.
Les remplacements soudains et inattendus de hauts responsables gouvernementaux ont accru la confusion et mis en exergue le rôle politique d’entrepreneurs influents. Bouteflika a nommé Abdelmajid Tebboune, ministre de l’Habitat du précédent cabinet et membre du FLN, que l’on dit proche du chef de l’Etat, pour remplacer Sellal au poste de Premier ministre en mai 2017. En tant que ministre du Commerce par intérim entre janvier et mai 2017, Tebboune s’était fait un nom comme figure de la classe dirigeante prête à s’en prendre aux barons de l’importation – ces individus disposant de liens politiques privilégiés et dont le succès dépend de la capacité à obtenir des licences d’importation (voire des monopoles) sur des marchés lucratifs. Pour réduire un déficit commercial en plein essor en raison de la baisse du cours du pétrole, il a rapidement décidé de suspendre un large éventail d’importations, ce qui a eu pour effet d’augmenter les prix et de geler les investissements industriels. En ciblant ouvertement les importateurs, considérés comme un groupe d’intérêt privilégié et surprotégé, il a suscité l’espoir que ses réformes économiques s’attaquent également à la corruption.Tebboune s’est saisi de sujets délicats politiquement, tels que les licences d’importation ou la réforme agraire ; par sa détermination, il a bousculé l’ordre établi, marchant sur les plates-bandes du président du FCE Ali Haddad.
L’affrontement Tebboune-Haddad a fait les choux gras des médias algériens : par exemple, les photos montrant Saïd Bouteflika embrassant chaleureusement Haddad et semblant ne faire aucun cas de Tebboune, à l’enterrement de l’ancien Premier ministre Redha Malek le 30 juillet dernier, ont été largement diffusées et interprétées comme un présage de la chute du Premier ministre. En limogeant Tebboune le 15 août, Bouteflika a semble-t-il signifié que les intérêts du monde des affaires étaient intouchables, quelle que soit l’urgence des réformes économiques.
Bien qu’il ait retrouvé une certaine marge de manœuvre, l’Etat a brandi des menaces voilées pour défendre sa politique économique, notamment en laissant entendre que la violence des années 1990 pourrait renaitre.Tebboune a laissé sa place à Ahmed Ouyahia, un apparatchik aguerri qui avait déjà occupé le poste de Premier ministre à trois reprises (1995-1998, 2003-2006 et 2008-2012) et était directeur de cabinet du président juste avant sa nomination. Homme fort du pouvoir algérien, il est souvent considéré comme un compromis entre des groupes d’intérêts concurrents et son nom est parfois cité comme président potentiel, dont pourraient s’accommoder la plupart des membres de l’élite dirigeante, malgré une image publique controversée.
Quelques semaines après sa nomination, Ouyahia a mis en œuvre l’assouplissement quantitatif, permettant ainsi au gouvernement de financer son budget et de gagner du temps, en pariant notamment sur une hausse rapide du cours du pétrole. Pour l’instant, ce pari semble porter ses fruits. Le gouvernement a pu éviter de nouvelles coupes, tandis que la montée du cours du pétrole qui a s’est engagée début 2018 a permis de lever la pression sur le budget.
B.Eviter les troublesBien qu’il ait retrouvé une certaine marge de manœuvre, l’Etat a brandi des menaces voilées pour défendre sa politique économique, notamment en laissant entendre que la violence des années 1990 pourrait renaitre. En septembre 2017, Ouyahia a déclaré devant le parlement que si le gouvernement ne mettait pas en œuvre sa politique d’assouplissement quantitatif, il manquerait de fonds pour payer les salaires des fonctionnaires dans les deux mois, insinuant que des troubles se profilaient. En octobre 2017, la chaîne publique ENTV a diffusé pour la première fois à la télévision algérienne des images explicites et profondément bouleversantes des massacres des années 1990. Ceci a été largement interprété comme un avertissement au public, sommé de se taire et d’être reconnaissant pour la stabilité du pays. L’intention semble être, comme en 2011, de dissuader la population de faire des vagues en protestant contre les décisions de l’Etat ou en les remettant en cause de quelque manière que ce soit.
Depuis fin 2016, avec l’annonce de la réduction du budget 2017, la contestation populaire des mesures d’austérité s’est manifestée de multiples façons. Les marches de protestation ont été pour la plupart spontanées, sans cadre organisationnel plus large et n’ont pas réussi à mobiliser les foules, à quelques exceptions près. Après l’adoption de la loi de finances pour 2017, un mouvement de protestation de cinq jours prévu du 2 au 7 janvier, accompagné d’appels à la grève générale lancés par une association de commerçants contre les restrictions à l’importation, les hausses d’impôts et les pénalités, a tourné à l’émeute.
Du 2 au 4 janvier, les manifestants se sont heurtés aux forces de sécurité dans plusieurs villes de la province de Béjaïa, dans l’Est de la Kabylie, ainsi qu’à Bouira et Aïn Benian, dans la périphérie d’Alger. De jeunes hommes ont attaqué des symboles de l’Etat, comme l’Office national de l’enseignement et de la formation à distance (ONEFD), pillé des biens dans des magasins de high tech et bloqué des routes. Les forces de sécurité ont utilisé des gaz lacrymogènes pour les disperser et des dizaines de manifestants auraient été blessés, ainsi que 39 policiers dans la seule région de Béjaïa. Les services de sécurité ont dispersé ou interrompu plusieurs autres marches de protestation. Des manifestations similaires ont eu lieu en 2018. En particulier, une grève des médecins a quasiment paralysé le secteur de la santé publique pendant six mois et forcé le gouvernement à faire des concessions.
Depuis que Bouteflika est au pouvoir, l’Algérie a beaucoup investi dans la réforme et la professionnalisation de ses services de sécurité, restaurant la confiance tant à l’intérieur du pays qu’à l’étranger. Les autorités ont pris conscience que des formes de violence et de surveillance considérées comme légitimes ou nécessaires pour combattre une insurrection ne le sont plus. Les arrestations préventives et le harcèlement et les persécutions à l’encontre de figures contestataires sont plus efficaces pour écraser la révolte populaire que d’autres méthodes moins ciblées, qui ont encouragé l’escalade dans les années 1990 en Algérie, et plus récemment ailleurs lors des soulèvements du printemps arabe. Mais l’Etat n’a pas encore testé ce changement de tactique policière à grande échelle, et le ressentiment, à force de s’accumuler, pourrait s’exprimer de façon soudaine. Les autorités sont particulièrement prudentes dans leur façon de répondre aux manifestations dans le Sud, où la contestation augmente.
IV.L’influence croissante du secteur privé A.Une classe qui gagne en pertinence politiqueLe Forum des chefs d’entreprise (FCE), dont le pouvoir s’est accru depuis 2014, semble sur le point de gagner encore plus d’influence politique. Le développement du secteur privé est de bon augure, car il devrait créer des emplois, diversifier l’économie et la rendre plus compétitive, mais il faudra faire preuve de vigilance et exercer un pouvoir de supervision pour exploiter, coordonner et orienter sa croissance. Ses détracteurs voient dans la montée en puissance du FCE après 2014 – lequel n’a pas la légitimité historique de l’armée ou du FLN – l’avancée d’une oligarchie susceptible d’influencer la politique de l’Etat en fonction de ses propres intérêts plutôt que de développer l’économie. Bien que le FCE se décrive comme une force de pression pour la réforme de l’économie, son influence politique croissante a suscité plus d’attention que ses objectifs affichés de réforme.
Depuis 2014, lorsque Haddad a financé la campagne de Bouteflika pour un quatrième mandat puis est devenu président du FCE, l’influence de ce lobby des entreprises n’a cessé d’augmenter. Elle a atteint de nouveaux sommets aux yeux du public en décembre 2016, lorsque Haddad a insisté – en dépit du protocole et après s’être vu refuser l’autorisation de le faire – pour prendre la parole devant le ministre des Affaires étrangères Ramtane Lamamra au Forum algéro-africain d’investissements et d’affaires, provoquant le départ de Sellal. Pour les experts comme pour la société, la décision de Bouteflika de limoger Tebboune en août 2017 – peu de temps après que ce dernier eut directement pris pour cible l’empire de la construction d’Haddad – a montré que le pouvoir d’Haddad surpassait désormais celui du chef du gouvernement. L’influence d’Haddad provient essentiellement de sa proximité réelle et supposée avec Saïd Bouteflika, le frère du président ; de nombreux Algériens ont noté que le limogeage de Tebboune a eu lieu quelques jours seulement après la publication dans les médias d’images montrant les deux hommes rire et monter ensemble à bord d’un véhicule gouvernemental.
La montée du FCE fait écho à l’importance politique croissante de la classe entrepreneuriale en général. En mai 2017, pour la première fois, des personnalités du monde des affaires se sont présentées aux élections législatives, en particulier comme candidats du FLN et de son partenaire dans la coalition présidentielle pro-Bouteflika, le Rassemblement national démocratique (RND). Leur influence croissante – en partie liée au rôle que plusieurs hommes d’affaires ont ouvertement joué dans le financement de la campagne pour la réélection de Bouteflika en 2014 – a été perçue comme une victoire pour les représentants du monde des affaires et, selon les critiques de gauche, une perte pour les représentants du peuple. Face à cette tendance, des commentateurs algériens ont affirmé que, lors des futures élections présidentielles, le soutien financier du monde des affaires pourrait devenir aussi important que le soutien politique des centres de pouvoir traditionnels tels que l’armée.
B.A qui appartient le secteur privé ?Les dirigeants du FCE se considèrent comme les gardiens d’une transition du socialisme étatique centralisé vers une économie de marché qui a commencé à la fin des années 1980 et a été interrompue par la décennie noire. Comme l’explique un membre du conseil exécutif du FCE :
Il faut qu’il y ait une transition pacifique d’un système à l’autre sans choc social trop fort. Nous sortons d’une période très difficile et nous ne pouvons pas y retourner. Il a fallu si peu de temps pour discréditer l’Algérie et si longtemps pour regagner la confiance des Algériens et des étrangers. En 1992, nous avons délaissé l’économie socialiste. Le processus de développement de l’entreprise privée n’a pas vraiment été lancé avant 2000, ce qui fait que nous n’avons que dix-sept ans. Les deux tiers des emplois et les trois quarts de la valeur ajoutée proviennent du secteur privé. Le budget de l’Etat devrait reposer davantage sur les impôts sur les entreprises et moins sur les recettes d’exportation.
Le FCE estime que les transferts de connaissances et de technologies provenant des investissements étrangers sont essentiels au développement d’un secteur privé fort. Il ne considère pas comme un facteur dissuasif l’obligation qu’au moins 51 pour cent des investissements en capital dans toute entreprise locale soient détenus localement, en dépit des complaintes récurrentes des investisseurs étrangers. Le FCE appelle à rationnaliser les dépenses sociales, qu’il juge très inefficaces, et met l’accent en particulier sur la réforme des subventions pour l’énergie et le logement. Il est aussi favorable à ce que l’intégration du secteur informel à l’économie formelle devienne une priorité : d’énormes quantités d’argent circulent dans une économie parallèle énorme, qui est plus flexible qu’un secteur bancaire et financier rigide et excessivement bureaucratique, et s’est montrée remarquablement résistante aux efforts visant à la réguler. La circulation informelle de l’argent prive non seulement le gouvernement de recettes fiscales mais rend aussi impossible le type d’analyse économique détaillée nécessaire à la planification.
Le besoin d’investissements et de partenariats étrangers pour soutenir l’entreprise privée a conféré une nouvelle importance diplomatique au FCE, ce qu’il a accueilli avec enthousiasme. Les délégations du FCE envisagent une Algérie transformée par rapport à l’époque socialiste, avec des entreprises privées nouvelles et dynamiques et un fort potentiel inexploité. Il a identifié les pays occidentaux et le Japon comme des partenaires d’investissement souhaitables, compte tenu des perspectives de transfert de connaissances et de technologies associées, et l’Afrique subsaharienne comme un marché d’exportation prometteur. Le FCE cherche à traduire les liens politiques et diplomatiques étroits entre l’Algérie et les pays africains en relations économiques.
Ses détracteurs reprochent au FCE d’incarner le côté rétrograde plutôt qu’innovateur de l’entreprise privée algérienne. Selon un analyste économique algérien :
Le FCE représente des intérêts libéraux, y compris ceux des barons de l’importation. Les barons de l’importation ne veulent pas de diversification et de production à l’intérieur du pays ; ils veulent des importations parce qu’elles leur permettent de manipuler le marché des devises. Leur modèle économique dépend de leur capacité à arbitrer [profiter de prix différents pour le même actif sur plusieurs marchés] en vendant des biens à des prix gonflés. Ce ne sont pas de vrais investisseurs capitalistes. Ils ne produisent rien. C’est ce groupe d’acteurs économiques qui a provoqué le limogeage de Tebboune.
Les responsables gouvernementaux et les membres du FCE semblent conscients du fait que les barons de l’importation doivent se tourner vers des secteurs plus productifs. « Les élites veulent empocher beaucoup d’argent, déclare un conseiller du gouvernement. Mais nous n’avons plus de devises étrangères. Il faut pousser les barons de l’importation à s’engager dans une activité productive. Les circonstances nous obligent à sortir de ce syndrome hollandais ».
Le FCE paie le prix de sa visibilité politique accrue : ses détracteurs le décrivent régulièrement comme un parasite à qui des faveurs ont été accordées et qui joue un rôle politique pernicieux. C’est en partie une caricature qui ne reflète pas la diversité de ses membres, mais c’est aussi la conséquence prévisible de sa politisation, laquelle récompense les chefs d’entreprise qui soutiennent le gouvernement et punit ceux qui le contestent. Les entrepreneurs à l’esprit indépendant doivent souvent faire face à de nombreux obstacles, comme l’a montré l’empoignade publique entre le gouvernement et l’industriel milliardaire Issad Rebrab, dont le groupe Cevital produit la majorité des exportations du pays, hors hydrocarbures.
V.Surmonter la paralysieL’Algérie est à la croisée des chemins. L’administration de Bouteflika, qui a exploité les traumatismes passés des Algériens pour prolonger son mandat, ne peut ou ne veut pas se saisir de la question successorale. Depuis plusieurs années, des personnalités algériennes se demandent régulièrement et publiquement si Bouteflika gouverne réellement le pays, et exigent avec toujours plus d’audace qu’il ne se présente pas pour un cinquième mandat. Des figures de l’opposition ont appelé, en vain, à une transition négociée qui s’attaque également aux problèmes économiques urgents. Pourtant, face à de tels appels, la présidence et la coalition politique qui la soutient ont choisi soit de garder le silence, soit de miser sur un autre mandat de Bouteflika comme ciment du système. Ces derniers veulent croire que de nombreux Algériens sont reconnaissants pour la paix dont ils jouissent depuis 1999 et s’inquiètent davantage de ce qu’un avenir inconnu pourrait leur apporter.
Il en résulte une paralysie croissante, qui se manifeste non seulement dans le statu quo politique dominé par le FLN et le RND, mais aussi en matière de politique économique et étrangère. Cette paralysie a notamment pour conséquence d’étouffer le débat qui n’a que trop tardé sur la manière de s’adapter à la baisse des revenus pétroliers et gaziers et de réduire la dépendance de l’Algérie aux hydrocarbures. Un tel débat doit avoir lieu à deux niveaux : entre les élites – les hommes d’affaires, les technocrates et les politiques – qui disposent d’une influence politique et le grand public, mais aussi entre ces élites elles-mêmes.
Que les changements économiques nécessaires surviennent de manière soudaine en réponse à la crise ou plus graduellement si la hausse du cours du pétrole permet de gagner du temps, le gouvernement doit dans un premier temps améliorer sa communication et sa capacité à faire passer des messages. Cette étape est nécessaire pour expliquer les défis à venir, la nécessité des réformes – y compris celles qui peuvent être impopulaires – et les résultats qu’elles sont censées apporter. Ces dernières années, le gouvernement a eu tendance à sous-estimer ou à masquer des données économiques inquiétantes, notamment l’évaporation des recettes d’exportation pour l’épargne et l’investissement. Un effort de transparence sur l’état des finances publiques et la manière dont l’argent public est dépensé serait important pour faire comprendre la situation économique du pays et éviter le type de réponses alarmistes qui peuvent prévaloir quand aucune information fiable n’est disponible.
La méfiance de nombreux Algériens à l’égard à la fois de l’Etat et du secteur privé, qui nait de l’impression qu’une petite élite s’est accaparée l’Etat, est un autre problème à régler. Ni les décideurs politiques ni leurs partenaires du secteur privé et du mouvement syndical ne devraient sous-estimer le rôle que joue la corruption dans l’imaginaire populaire; en particulier, les scandales de la banque Khalifa et de la Sonatrach ont érodé la confiance tant des Algériens que des investisseurs étrangers. Mi-2018, la saisie de plus de 700 kilogrammes de cocaïne dissimulée dans une cargaison de viande congelée appartenant à un homme d’affaires influent a provoqué la consternation ; certains y ont vu le signe de la complicité présumée de hauts responsables sécuritaires dans le crime organisé.
Si les responsables politiques veulent répondre aux préoccupations du public face à la corruption, ils pourraient envisager de tenir pour responsables les auteurs des excès les plus flagrants du passé, mais il s’agit d’un choix risqué d’un point de vue politique car il pourrait porter atteinte à des intérêts particuliers. Une lutte plus résolue contre la corruption risque aussi de devenir une chasse aux sorcières politisée, surtout dans un contexte de renouvellement annoncé au sommet de l’Etat. Une solution plus satisfaisante pourrait consister à réduire le risque que de tels cas se reproduisent, par exemple en nommant une commission d’experts chargée d’examiner la législation et les procédures administratives existantes et de proposer des réformes pour améliorer le contrôle des dépenses publiques.
Toute renégociation du contrat social post-1990 – dépenses publiques généreuses, y compris pour le développement de nouvelles élites économiques, en échange du consentement politique au pouvoir de Bouteflika et de l’impunité des auteurs de violences pendant la guerre civile – doit être envisagée avec prudence. La génération née dans les années 1990 a peu de souvenirs de cette décennie de violences et devra faire face à une hausse des prix des produits de base à mesure que le gouvernement éliminera les subventions. Les moins de 30 ans – 70 pour cent de la population – entrent aujourd’hui sur le marché du travail avec de sombres perspectives d’avenir et une capacité considérablement réduite de l’Etat à les soutenir. Alors que certains s’indignent du retournement de conjoncture, d’autres le perçoivent comme une chance : il y a une volonté au sein de ce groupe de se faire sa propre place et de réduire sa dépendance à l’égard de l’Etat. Selon Abdellah Malek, 28 ans, qui dirige une start-up technologique à Alger :
Une grande partie de la société reçoit des choses gratuitement depuis vingt ans. Les gens doivent travailler dur pour se libérer de leur dépendance. Si les entrepreneurs ne sont pas capables de faire les choses par eux-mêmes, ils compteront toujours sur l’aide du gouvernement ; une trop grande partie de la société souffre déjà de cette mentalité à cause des revenus pétroliers.
La mise en œuvre d’une transition qui s’écartera du modèle économique actuel exigera plus de transparence et d’ouverture à tous les niveaux.La perception du grand public selon laquelle la corruption est répandue parmi une petite élite d’entrepreneurs et de décideurs politiques est intimement liée à la relation entre une poignée de hauts responsables et les élites économiques influentes sur le plan politique. « Séparer l’argent du pouvoir politique », comme l’ancien Premier ministre Tebboune l’a promis – ce qui lui aurait coûté son poste, selon de nombreux observateurs – est un slogan politiquement lourd qui contraste avec la réalité : de puissants hommes d’affaires s’organisent pour défendre leurs intérêts personnels et d’entreprises, et la lutte contre la corruption est trop souvent utilisée comme arme politique. Une meilleure approche consiste à accroitre le nombre de parties prenantes dans la formulation de la politique économique.
Une partie de la controverse autour de l’influence du FCE est d’ordre idéologique, reflétant les clivages typiques entre la droite et la gauche ou entre le libéralisme et l’étatisme qui peuvent généralement être résolus par le rééquilibrage du pouvoir des élites et les résultats des élections. Mais le problème du FCE réside aussi largement dans la perception qu’il incarne les intérêts de la classe dirigeante et d’une nouvelle élite plutôt que les intérêts économiques du pays dans son ensemble, bien qu’il en soit le principal réformateur. Comme le confie un conseiller en politique économique, « la Tripartite devrait être élargie. Si l’on cherche à construire un consensus populaire autour des réformes, le fait que seuls l’UGTA et le FCE soient représentés a un impact négatif ». Tendre la main aux brebis galeuses du monde des affaires, y compris à ceux qui sont perçus comme des critiques du gouvernement de Bouteflika, comme Issad Rebrab, pourrait non seulement enrichir le débat sur la politique économique de points de vue différents, mais aussi désamorcer les accusations selon lesquelles le FCE défend les intérêts d’une faction en particulier plutôt que du secteur privé dans son ensemble.
VI.ConclusionLa décennie noire a laissé un héritage complexe en Algérie. Le pays a appris que libéraliser trop rapidement son économie sous la pression soudaine d’une dette extérieure croissante n’était pas sans danger, et il a la ferme intention d’éviter de répéter les erreurs du passé. L’Algérie doit maintenant trouver un équilibre entre la nécessité d’un ajustement économique et des intérêts particuliers, qu’il s’agisse d’hommes d’affaires privilégiés ou d’acteurs de la société qui considèrent des changements rapides et substantiels au modèle redistributif comme trop perturbateurs. Ce modèle, aussi inefficace qu’il soit, a permis à de nombreuses personnes de sortir de la pauvreté et a contribué à stabiliser un pays déchiré par la guerre.
La mise en œuvre d’une transition qui s’écartera du modèle économique actuel exigera plus de transparence et d’ouverture à tous les niveaux, ainsi qu’une plus grande obligation de rendre compte pour les institutions publiques et le secteur privé. En fin de compte, la réforme profonde dont l’Algérie a besoin nécessite une ouverture stratégique tant vis-à-vis de l’étranger qu’au sein même du pays, pour permettre à divers acteurs économiques, politiques et sociétaux de participer à la construction d’un nouveau modèle pouvant assurer à la fois stabilité et croissance. L’attitude actuelle du gouvernement, qu’il s’agisse de prendre des décisions économiques majeures ou d’aborder des questions politiques et sociétales plus larges, est trop souvent distante, arrogante et en décalage avec les attentes des Algériens.
Malgré l’incertitude politique qui prévaut avant l’élection présidentielle de 2019 et, plus généralement, la transition présidentielle qui se profile et pourrait ou non s’aligner sur le calendrier électoral, quelques premières mesures prudentes sont possibles. Il pourrait s’agir notamment d’améliorer la transparence sur l’état des finances publiques et d’élargir le débat sur les défis auxquels l’Algérie est confrontée et sur la meilleure façon de les relever au-delà des acteurs du monde des affaires et de la société civile qui participent déjà au processus décisionnel. Les jeunes Algériens en particulier – qui représentent la majeure partie de la population et dont l’avenir est en jeu – devraient être au cœur de toute initiative visant à trouver une solution de long terme aux défis économiques.
Comme de nombreux autres problèmes en Algérie, les questions de réforme économique ont eu tendance à être reportées, alors que les partisans du changement attendent l’émergence d’une classe dirigeante davantage tournée vers l’avenir. Mais cela pourrait prendre un certain temps, et les décideurs actuels devraient comprendre qu’il serait plus avisé – pour eux-mêmes et pour l’Algérie – de prendre une longueur d’avance et d’éviter une crise future plutôt que de faire face au choc lorsqu’il surviendra. Il n’est pas trop tôt pour élargir le cadre d’un débat qui porte autant sur l’évolution du modèle social algérien que sur les mesures techniques nécessaires pour mettre en œuvre ces réformes correctives.
Alger/Bruxelles, 19 novembre 2018
Source : International Crisis Group (ICG), une importante organisation internationale dont la mission est de prévenir et résoudre les conflits meurtriers grâce à une analyse de la situation sur le terrain et des recommandations indépendantes. L’ICG est considéré comme les yeux et oreilles du monde face à l’imminence de conflits et dispose d’un conseil d’administration jouissant d’une grande influence et capable de mobiliser une action efficace de la part des décideurs politiques du monde entier.
- CRB - PAC : Une place de dauphin en jeu pour le Chabab
- Mikhail Bogdanov reçu par Tebboune : L’Algérie et la Russie consolident leurs relations
- Après les viandes et les poissons : Y-a-t-il une spéculation sur les prix du café ?
- CSC - Le rêve grandissant des Sanafir en coupe : L’appétit vient en mangeant
- CSC - Le rêve grandissant des Sanafir en coupe : L’appétit vient en mangeant
- ESS : Prêts pour la JSS
- Suite à la riposte iranienne: La Malaisie appelle à une désescalade au Moyen-Orient
- Appel à participation au colloque sur les transformations du théâtre en Afrique à l’ère des médias
- Education nationale : Les orientations de Belabed pour le 3e trimestre
- Rumeurs sur une révision de l’allocation chômage: La Présidence dément
- USMA - Après sa brillante qualification pour les ¼ finale : Cap sur l’US Biskra
- ESS : L’Entente met le paquet pour Chetti et Draoui
Infos régionales

Annuaire des sites algériens
Autres sites
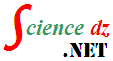
Le site des sciences en Algérie
Vous cherchez un emploi? Essayer la recherche d'emploi en Algérie
 Babalweb Annonces
Babalweb AnnoncesPetites annonces gratuites
