Enquête. Dans la tête des Harragas algériens
« J’aime mon pays, c’est mon pays qui m’aime pas » !

Les Algériens, principalement des jeunes hommes, tentent de quitter leur pays, sans passeport ni visa, sur des barques, au péril de leur vie. En dialecte maghrébin, on nomme ces candidats à l’émigration harraga (les “brûleurs”), car ils “brûlent” les frontières et les étapes nécessaires à une migration légale. En outre, s’ils arrivent en Europe, ils détruisent, ils “brûlent” leurs papiers d’identité pour tenter d’échapper à l’expulsion près les hittistes des années 1980 et ceux qui ont rejoint les groupes islamistes armés durant le conflit des années 1990, les harraga sont érigés au rang de figure symbolisant le désespoir de la jeunesse algérienne durant les années 2000. Ils sont invoqués comme preuve ultime des dysfonctionnements qui touchent le pays.
Établie en Algérie entre janvier et juillet 2011, alors que les soulèvements battaient leur plein dans le monde arabe, nous menions une étude de terrain concernant la portée de ce phénomène migratoire sur la société que les harraga tentent désespérément de quitter. Le déséquilibre constaté par Abdelmalek Sayad entre la littérature sur l’émigration et celle sur l’immigration inspirait ces recherches.
Dans un article qui avait pour titre “Le phénomène migratoire : une relation de domination” il décrivait une littérature sur l’émigration défaillante et subordonnée à la littérature sur l’immigration et appelait au développement d’une science de l’émigration qui serait une science de l’absence et des absents. C’est afin d’y contribuer que nous avons entrepris une série d’entretiens semi-directifs dans deux régions particulièrement touchées par les départs des harraga : la région d’Oran dans l’Ouest algérien et celle d’Annaba dans l’Est.
Une grande partie de ces entretiens fut menée auprès de candidats à el-harga… ayant fait d’une à quatre tentatives de départ s’étant soldées par des échecs. Menés en dialecte à l’aide d’une grille d’entretien souple, ces interviews firent une place importante à l’analyse de la situation politique en Algérie et dans les pays proches touchés par les révoltes arabes (particulièrement la Tunisie, l’Égypte et la Libye). Ce déplacement spontané des thématiques de l’entretien traitait le résultat de deux dynamiques: d’une part, les événements en cours avaient une importance majeure et recevaient un traitement médiatique très intense ; d’autre part, l’Algérie était concernée.
Du 3 au 6 janvier 2011 le pays fut touché par des émeutes de très grande ampleur et divers partis politiques et organisations tels que la Coordination nationale pour le changement et la démocratie (cncd) appelaient le peuple algérien à manifester.
En outre, la thèse de la “contagion” et le supposé “effet domino” dominaient les analyses sur les soulèvements dans le monde arabe. Les articles se multipliaient dans la presse et les commentateurs se succédaient sur les plateaux de télévision glosant sur la probabilité que l’Algérie soit “la prochaine sur la liste”.
Les similarités entre la situation algérienne et celle des pays voisins touchés par les soulèvements étaient mises en exergue : une population jeune, un taux de chômage élevé, une inflation conjuguée à une stagnation des salaires, le caractère non démocratique des institutions politiques, la corruption, etc.
Aussi, lors de nos entretiens, les harraga commentaient-ils, sans y avoir été explicitement invités, la situation politique et le cours des événements dans les pays touchés par les soulèvements, le cours que prenaient ces entretiens inspirant de nouvelles interrogations. Pourquoi ces jeunes urbains qui se sentaient marginalisés souhaitaient-ils entreprendre une aventure migratoire aussi risquée plutôt que de demeurer en Algérie, manifester et protester afin de changer la situation dans le pays ? C’est à cette question que la présente contribution sera consacrée.
Lors des entretiens il était demandé aux harraga de décrire leur quotidien. Ce qui prédominait alors était leur impression de “mal-vivre”. La “mal-vie”, dite en français, est une expression très utilisée en dialecte algérien. La “mal-vie” est d’abord économique, elle est due à la précarité des emplois et à la faiblesse des salaires.
La quasi-totalité des harraga n’avait pas de travail formel au moment des entretiens. La plupart disaient qu’ils “naviguaient”, expression qui désigne une forme de débrouille, un revenu faible et l’absence de stabilité. Ils sont vendeurs à l’étalage, boulangers, pêcheurs ou chômeurs. La faible visibilité qu’ils ont de leur avenir financier, l’absence de revenu en cas de maladie ou en cas de saisie de leur marchandise dans le cadre de la lutte contre le commerce informel contribuent à leur mal-être.
Mohammed a fait une tentative de départ au moment de l’entretien et économise pour une seconde tentative : « J’ai 23 ans et je n’ai rien. Je suis vendeur de cigarettes à l’étalage. Je travaille au jour le jour. Parfois, on [les policiers] m’arrête et on me confisque tout. Il y a des bonnes journées, mais je ne peux pas me faire un avenir comme ça. L’essentiel, c’est de partir ». Ali a le même âge. Il est coiffeur. Lorsqu’il parle de la vie, il déclare : « Tu travailles, tu manges et tu bois. Tu n’as pas d’avenir ». Toutes leurs journées se ressemblent : un quotidien sans loisirs et un avenir sans perspective.
Cette situation est d’autant plus difficile à vivre que l’ordre socio-économique apparaît illégitime et la réussite déconnectée de l’effort. Sofiane, 30 ans, est d’autant plus frustré que ce qu’il désire ne lui semble pas déraisonnable : « Je veux un travail ; ça changerait tout. Je dirai merci mon Dieu. Je me marierai. Je me construirai une vie comme mes parents l’ont fait avant moi. Mais, eux, ils ne te laissent pas. Si je reste à attendre, je n’aurai rien. Je perdrai ma vie, comme ça… Ils parlent de pré-emplois, d’emplois jeunes, mais en réalité, pour les obtenir il faut payer des bakchichs ou connaître une personne bien placée. Dans ce pays on ajoute de l’eau à la mer, on ne donne qu’à ceux qui ont déjà. Nous, on ne nous donne rien. Aujourd’hui, si je veux travailler comme agent de sécurité, disons dans un dépôt ou n’importe quelle entreprise, je donne mon cv […]. La personne chargée du recrutement m’appelle et me dit de me présenter. Quand je me présente, il m’attend à l’extérieur et me dit : “Tu me donnes 70 000 dinars [environ 700 €] et le poste est pour toi, mon ami”. Comment ils osent te demander de l’argent alors que tu veux travailler ? ».
Ainsi, cette “mal-vie” due à la précarité de leur situation économique est à lier à un profond sentiment d’injustice. Ils ont la conviction que les richesses du pays sont confisquées et qu’ils ne pourront jamais y avoir accès. Les harraga affirment qu’il est impossible de réussir sans argent, car celui-ci permet de corrompre, et sans réseau à mobiliser. Ils ne voient pas d’amélioration possible de leur situation, quels que soient leurs efforts. Ils insistent sur l’incapacité à obtenir leur dû et l’injustice qui règne dans le pays. Larbi, 24 ans, a fait deux tentatives de départ en barque en 2010. Il déclare ne rien comprendre à son pays, où la loi ne s’applique qu’aux pauvres et aux faibles. Ali, 23 ans, a ainsi confié : « J’aime mon pays, c’est mon pays qui m’aime pas ».
Il existe une expression en dialecte, hogra, qui revient souvent lors des entretiens. Ce terme, qui signifie littéralement “mépris”, a un sens bien plus vaste et désigne un abus de pouvoir qui crée un sentiment de frustration et d’impuissance chez celui qui le subit. Souvent synonyme d’injustice et d’impunité, hogradésigne également le mépris des dirigeants pour leur peuple. Les harraga dénoncent la collusion entre élites économiques et élites politiques. Ils décrivent, dans leur ensemble, un système économique et politique illégitime et non méritocratique (certains interviewés ont qualifié le système algérien de “médiocratie” et de “voyoucratie”).
Les dirigeants sont d’autant moins légitimes que certains interviewés avaient l’impression que quelques-uns de ces dirigeants fuyaient le système qu’ils avaient mis en place, évitant ainsi les dysfonctionnements qu’eux-mêmes font perdurer dans les établissements scolaires et dans les hôpitaux publics algériens en envoyant leur famille s’instruire et se soigner en Europe. Larbi a ainsi déclaré qu’il ne souhaitait pas grand-chose, qu’il se contenterait des « miettes » de ce que les dirigeants donnent à leurs enfants.
Un texte extrait de l’enquête menée par Farida Souiah, chercheur au laboratoire méditerranéen de sociologie basé à Marseille.
- CRB - PAC : Une place de dauphin en jeu pour le Chabab
- Mikhail Bogdanov reçu par Tebboune : L’Algérie et la Russie consolident leurs relations
- Après les viandes et les poissons : Y-a-t-il une spéculation sur les prix du café ?
- CSC - Le rêve grandissant des Sanafir en coupe : L’appétit vient en mangeant
- CSC - Le rêve grandissant des Sanafir en coupe : L’appétit vient en mangeant
- ESS : Prêts pour la JSS
- Suite à la riposte iranienne: La Malaisie appelle à une désescalade au Moyen-Orient
- Appel à participation au colloque sur les transformations du théâtre en Afrique à l’ère des médias
- Education nationale : Les orientations de Belabed pour le 3e trimestre
- Rumeurs sur une révision de l’allocation chômage: La Présidence dément
- USMA - Après sa brillante qualification pour les ¼ finale : Cap sur l’US Biskra
- ESS : L’Entente met le paquet pour Chetti et Draoui
Infos régionales

Autres sites
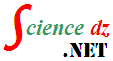
Le site des sciences en Algérie
Vous cherchez un emploi? Essayer la recherche d'emploi en Algérie
 Babalweb Annonces
Babalweb AnnoncesPetites annonces gratuites