Enquête. Pourquoi et comment l’Algérie a raté sa transition du socialisme à l’économie de marché

Depuis le contre-choc pétrolier de 1986, la prise de conscience du danger que représentait la dépendance de l’économie algérienne de la rente énergétique s’est généralisée. Au sommet de l’Etat, l’idée des réformes économiques gagnait en crédit et en partisans. L’installation de l’équipe de réformes et les pouvoirs qui lui furent attribués en est un signe évident.
Dès 1987 en effet, l’équipe des réformateur lança un projet de réformes pour autonomiser les entreprises publiques et le secteur agricole en vue de les rentabiliser. Un projet qui était d’une portée certes limitée à cause de l’environnement économico-institutionnel fort contraignant. Mais il a néanmoins jeté les jalons du démantèlement des mécanismes rentiers de l’économie administrée.
Après les événements d’Octobre, le projet des réformateurs – au départ limité à l’aspect strictement économique- se transforme en double transition politique et économique dont l’objectif est de rompre avec le système du parti unique et de l’économie administrée. Concrètement, cette expérience s’est traduite par une modification radicale de l’environnement politico-administratif régissant l’activité économique du pays.
Cette expérience rappelle sur plusieurs aspects la transition pacifique vers la démocratie et le marché des Pays de l’Europe Centrale et Orientale (PECO) après l’effondrement de l’URSS et la chute du Mur de Berlin. Comme en Europe de l’Est en effet, les réformateurs cherchaient à remettre en cause les mécanismes rentiers de l’économie administrée afin de permettre aux dynamiques d’accumulation de s’enclencher. Cependant, une puissante opposition à cette démarche s’est engagée, notamment au sein des acteurs influents du champ politique algérien. L’expérience fut nettement stoppée après la chute du gouvernement de M. Hamrouche, en juin 1991, soit 23 mois après son installation.
Deux années après la remise en cause de l’expérience des réformateurs, l’Etat algérien s’est avéré incapable d’honorer ses engagements internationaux quant aux paiements de sa dette extérieure. Conséquence : après une longue hésitation, l’Etat engagea des négociations avec les institutions financières internationales, signa en avril 1994 le premier accord pour le rééchelonnement de sa dette extérieure et accepta l’application d’un Plan d’Ajustement Structurel (P.A.S) sous l’égide du FMI. Ce sera l’objet du prochain chapitre. A présent, nous nous pencherons sur la présentation et l’analyse des différents contextes et actions ayant marquées la double transition vers la démocratie et le marché initiée par le gouvernement réformateur de M.Hamrouche au début des années 1990.
Les événements d’Octobre marquèrent une nouvelle étape dans l’histoire de l’Algérie indépendante. Ils provoquèrent, tant au plan politique qu’économique, une rupture profonde jamais connue auparavant, par la remise en cause le monolithisme politique et le système de planification centralisée en œuvre depuis l’indépendance du pays en 1962.
En effet, cinq jours après le début des événements sanglants d’Octobre, le Président Chadli prononça un discours historique à la Nation, promettant des réformes économiques et politiques profondes. Depuis, l’histoire de l’Algérie s’accéléra jusqu’au « renvoi» du gouvernement de M. Hamrouche (en 1991) et la gravissime crise politique de janvier 1992 qui marqua le début d’une régression multiformes (politique, économique, sociale, culturelles…) dont les prolongements se font encore sentir aujourd’hui.
Les conséquences immédiates des événements d’octobre et l’intermède du gouvernement de Kasdi Merbah :
D’habitude désintéressé de la gestion des affaires internes, le président Chadli réagit au lendemain des événements sanglants d’Octobre, reprit l’initiative et exerça plusieurs de ses prérogatives. Il limogea M.C. Messaadia, Secrétaire-général du FLN, le général Madjoub Lakhal-Ayat, chef de la sécurité militaire, et initia une révision constitutionnelle par référendum un mois après les événements. Le congrès du FLN de 1989 donna la réplique aux initiatives du Président en adoptant trois résolutions politiques importantes : la première fut la reconnaissance des sensibilités politiques au sein du parti unique. La seconde décision fut l’ouverture des élections à tous les citoyens, adhérents ou non au parti. Enfin, la troisième fut la suppression de la tutelle du FLN sur les organisations culturelles et socio- professionnelles, dites de masses. Ces mesures sont importantes à souligner car elles montrent la volonté de mettre fin aux monopolisations tous azimuts sur la vie politique du pays érigées en dogme depuis l’indépendance en 1962.
Sur le plan économique, le congrès adopta des résolutions aussi importantes que les résolutions politiques susmentionnées. Elles soulignaient sans ambiguïté la nécessité d’associer les citoyens au processus de prise de décision en tant qu’acteur à part entière. Ce long passage les résume parfaitement : « les réformes entreprises à ce jour, qu’elles portent sur la décentralisation des activités administratives et / ou sur celles liées aux activités économiques comme les réformes économiques que nous voulons accélérer, procèdent de cette conviction que c’est en exerçant effectivement tous ses droits que le citoyen assumera le devoir de mieux gérer, mieux comprendre l’intérêt national et mieux s’organiser à la base pour s’adapter rapidement aux mutations qu’ exige le développement accéléré dans un monde difficile… Nous devons de manière systématique lutter contre la tendance à la confiscation des pouvoirs par les appareils, à l’origine de nombreux problèmes dont souffre notre société et qui développent l’esprit d’assisté, le mépris du citoyen et de l’individualisme …cette tendance que nous avons eu longtemps la naïveté de privilégier, pensant qu’elle allait accélérer le progrès économique, déresponsabilise de fait totalement le citoyen qui, de plus en plus, pour tous ces actes de la vie quotidienne, s’en remet à l’Etat considéré comme un recours permanant. Notre pays en a fait une amère expérience en donnant l’illusion que les structures publiques sont seules à même de régler tous les problèmes de la vie en société, et ceux inhérents à la vie en collectivité ».
Ce texte est intéressant car, pour la première fois dans l’histoire des réformes en Algérie, le lien entre les réformes économiques et les réformes politiques était clairement établi.
Parmi les décisions du congrès, il y a eu également la cooptation de Ch. Bendjedid pour un troisième mandat présidentiel. Ce dernier, une fois « élu », désigna K. Merbah comme Premier ministre chargé d’appliquer les résolutions sus-citées.
La désignation de K. Merbah à la tête du gouvernement, au lendemain d’octobre, ne peut s’expliquer sur le plan économique. L’homme était un fidèle de H. Boumediene, attaché au système étatiste et avait participé directement aux côtés de A. Brahimi à la gestion de la période précédente ; or, la perspective était d’engager des réformes radicales dans l’objectif de rompre avec l’économie administrée et du système de représentations politique et syndicale imposés par le parti unique.
La logique aurait été de confier le gouvernement aux réformateurs. Ces derniers, pour le rappel, étaient les principaux concepteurs des réformes engagées au lendemain de la crise de 1986. Ils avaient affiché clairement leur conviction d’une nécessaire double rupture avec la monopolisation du pouvoir politique et la gestion administrée de l’économie. Mais les enjeux du pouvoir et des intérêts qui lui sont associés obéissaient à une autre logique. Encore une fois le politique primait sur l’économique dans le choix des projets et des hommes pour les mettre en œuvre.
A ce propos, selon plusieurs observateurs, le président Chadli aurait été « forcé » dans une ultime tractation avec ses paires de l’armée à accepter K. Merbah comme chef de gouvernement. L’armée avait certes admis une « certaine » ouverture, mais ne voulait en aucun cas perdre totalement le contrôle de l’évolution du pays. En ce sens, K. Merbah est la personnalité toute désignée pour assurer le contrôle militaire de l’évolution politique de l’Algérie post-1988. En effet, ce dernier, n’est pas un inconnu dans la vie politique du pays : K. Merbah est le premier responsable de la Sécurité Militaire (la police politique) sous H. Boumediene, il est parmi les principaux désignateurs de Ch. Bendjedid à la présidence en 1979. Mais il sera vite écarté par Chadli et s’enlise depuis dans des postes ministériels subalternes ; le dernier en date est le poste de ministre de l’agriculture dans le gouvernement de A. Brahimi.
Le retour de cet ancien militaire (K. Merbah) aux affaires comme chef de gouvernement aux côtés de celui qui l’avait écarté une décennie auparavant constituait en effet un gage de garantie important pour l’armée. Il assurait les intérêts de la vieille garde militaire en faisant contrepoids au Chef de cabinet du président, L. Belkheir, qui lui, était issu des anciens officiers de l’arméefrançaise et veillait à ce que les réformes économiques en perspective ne bouleversent pas totalement le fonctionnement global du système en place.
Le bilan du gouvernement K. Merbah confirme largement la thèse avancée ci-dessus. Les réformes économiques, pourtant jugées prioritaires, n’ont pas avancé plus qu’en 1988. Le passage à l’autonomie des entreprises est resté au stade de projet et les fonds de participation déjà installés n’ont pas été rendus opérationnels. Pire encore : l’opération de restitution des terres agricoles nationalisées dans les années 1970 a connu des dérives importantes jetant un discrédit sur toute la démarche de réforme : « le Premier ministre »,souligne F. Ghilès, « comprend vite le parti qu’il peut tirer des réformes pour consolider ses clientèles, mais cette démarche salit l’esprit des réforme et souligne à quel point Kasdi Merbah reste prisonnier d’un milieu pour lequel l’action politique est essentiellement affaire de manipulation ».
Au lieu de poursuivre et d’approfondir les réformes nécessaires au passage vers le marché, le gouvernement tenta un programme de relance économique par l’investissement étatique dans le BTP en s’appuyant sur l’aide extérieure et l’augmentation des ventes d’hydrocarbures. Dans cette perspective, le ministre de Finances conclura, dès mai 1989, le premier prêt dit stand-by avec le FMI, et le ministre de l’Energie tenta de redynamiser le secteur des hydrocarbures. L’obsession de financement immédiat poussa le Premier ministre jusqu’à proposer aux banques françaises de gager l’Or des réserves de la Banque d’Algérie pour lever de nouveaux fonds.
Pendant ce temps, la situation socio-économique du pays continuait à se dégrader, notamment à cause de la gestion hasardeuse du contrechoc pétrolier (voir chapitre précédent). L’effet conjugué du recours systématique à la planche à billets, de l’endettement, de l’injection des sommes importantes de la monnaie sous forme de salaires et autres assainissements du secteur public, provoqua une inflation et un éclatement monétaire sans précédent.Fin 1989, le déficit du trésor auprès de la Banque Centrale atteignit 200 milliards de $, celui du secteur public 160 milliards de $, et 50% de la masse monétaire échappa totalement aux circuits bancaires. Encouragée par les événements d’Octobre, la population s’organisa et revendique publiquement ses droits. Le pays connut la plus importante vague de mécontentement social, 1095 grèves pour le premier semestre 1989.
La cohabitation entre le Président et son chef de gouvernement ne dura pas longtemps. Près d’une année après son installation, Merbah fut évincé, mais non sans difficultés. K. Merbah était un homme de pouvoir ambitieux et ne comptait pas céder devant les pressions du Président. Il réagit en arguant que son limogeage était anticonstitutionnel, le chef de gouvernement étant uniquement responsable devant le parlement.
Il est certainement peu utile d’épiloguer sur la pertinence juridique de l’argument avancé par K.Merbah. Néanmoins, il est important de remarquer que, pour la première fois dans l’histoire de l’Algérie indépendante, l’éviction d’un responsable politique devint une affaire publique. Aussi, la référence à la Constitution -donc au droit- était évoquée par les parties en conflit. Ceci peut être qualifié comme étant une avancée importante dans les mœurs politiques du pays. Il dénote l’intériorisation des acteurs politiques du devoir de se soumettre aux lois dans la prise de décision. Cet acquis était important pour les promoteurs du fonctionnement moderne des institutions. L’épisode de l’éviction de K. Merbah et la mini-crise que ce dernier provoqua est d’autant plus intéressant quand on sait que depuis près de trois décennies, les désignations et les limogeages des responsables sont quasiment un « fait de prince » que se partagent les décideurs civils et militaires, notamment ceux des services de sécurité.
K. Merbah enfin évincé, l’armée n’avait d’autres choix, après plusieurs mois de tergiversations, que d’accepter à nouveau le recours aux réformateurs. En septembre 1989 M. Hamrouche est désigné chef de gouvernement : « Sous la pression des évènements, le président convainc les militaires d’appeler à la direction le gouvernement des réformateurs favorables au changement démocratique et hostiles à l’affairisme. Surpris, et irrité d’avoir à sauver les meubles, mais fidèle à ses convictions, Mouloud Hamrouche exige les pleins pouvoirs pour mener la transition démocratique à son terme et appliquer intégralement les réformes. Le contrat explicite, est rendu public dès la nomination du nouveau chef de gouvernement », témoigne G. Hidouci. Ainsi, la réflexion de « l’équipe des réformateurs » dont l’objectif premier était l’allègement du système de planification et l’autonomie des entreprises publiques, se transformait de facto, en un programme politique de transition. La mission du gouvernement réformateur était de mettre en œuvre les réformes politiques et économiques conformément à l’esprit de la Constitution de février 1989.
La mission du gouvernement réformateur de M. Hamrouche n’était pas aisée, notamment lorsque l’on sait qu’il comptait réformer un système caractérisé par l’absence de normes de gestion et d’institutions capables de les faire respecter. L’Algérie vivait depuis son indépendance avec seulement un pouvoir politique dont la prise de décision était occulte. Par conséquence, dans une situation de quasi absence d’Etat, ce dernier était réduit à une charpente administrative sans autorités aucune. A ce propos, M. Harbi souligne : « L’absence de l’Etat est une constante de la vie politique depuis 1962. Les institutions sont des formes vides. Il est impossible, sauf pour les cercles étroits d’initiés, de désigner le lieu où se prennent les décisions politiques », avant d’ajouter que le système étatiste algérien échafaudé de l’indépendance en 1962 à 1989, est caractérisé par trois éléments de continuité « une indissociable unité entre le politique et l’économique (…) la crise d’autorité sur les lieux de travail et dans les administrations, îlots de pouvoirs quasi autonomes (…) Enfin, « Le quadrillage des administrations économiques (commerce, agriculture, industrie) par les réseaux de clientèle ».
C’est pour redresser cette situation que le gouvernement des réformateurs s’est engagé en septembre 1989. Pour les réformateurs, la résolution du problème du déficit des entreprises publiques nécessitait la soumission de l’acte de production et de distribution aux lois du marché national et international. Ceci supposait à l’évidence, qu’il soit mis fin aux ingérences extra-économiques et à toutes les formes de prédation que favorisait l’économie administrée. Dit autrement, l’émancipation de la sphère économique de la tutelle politique par l’édification d’un ordre institutionnel nouveau, fondé sur la soumission des acteurs et des institutions à la règle de droit. Tels étaient les grands chantiers de cette nouvelle vague de réforme que le gouvernement Hamrouche comptait mener. Mais les moyens de cette politique étaient-ils réunis ?
La période allant de juin 1991 à mai 1993 a été marquée par une agitation politique sans précédent. C’était une période de tâtonnements et de tergiversations. L’armée, qui s’était officiellement retirée du champ politique en 1989, revint sur le devant de la scène et prit directement en main la gestion des affaires publiques -ceci ne pouvant être, évidemment, sans influence sur la politique économique du pays. Les décideurs algériens, après avoir choisi S.A. Ghozali pour « réformer les réformes » initiées par le gouvernement de M. Hamrouche, changèrent de registre et nommèrent aux affaires B. Abdeslam. Ce dernier, connu pour son attachement à l’étatisme tous azimuts, tenta de réinstaurer le dirigisme économique : ainsi l’Algérie passa, en quelques mois, d’une transition vers le marché à une politique active pour neutraliser les lois du marché. En termes de projets et de visions économiques d’avenir, les gouvernements de S.A. Ghozali et de B. Abdeslam divergeaient mais partageaient le mythe du retour vers « l’ère bénie » des hydrocarbures qui pourvoyaient à tous les besoins sociaux et économiques de la population.
Le Gouvernement de S.A. Ghozali (1991-1992) : les réformes économiques en veilleuse :
Après l’intervention musclée de l’armée en juin 1991, l’instauration de l’état de siège et la « démission » du gouvernement réformateur, les décideurs algériens installèrent un nouveau gouvernement sous la direction de S.A. Ghozali. Ce dernier était officiellement chargé de préparer les élections législatives prévues pour la fin décembre de la même année.
Le gouvernement de S.A. Ghozali n’avait pas de programme économique proprement dit. Sa durée d’exercice était fixée à six mois mais il est resté un an. Progressivement, le gouvernement de S.A. Ghozali s’écarta de sa mission originelle et se consacra à la remise en cause de la plupart des mesures réformatrices prises par son prédécesseur.
En effet, en dépit de son discours sur la nécessité de la réforme, le gouvernement de S.A. Ghozali procéda au gel systématique de la plupart des dispositions prises par son prédécesseur. Le gouvernement justifia cette politique par la nécessité de rendre la réforme socialement acceptable ; au nom de l’impératif de réunir les conditions « optimales » pour la tenue des élections législatives « propres et honnêtes ».
L’ensemble des mesures « jugées » socialement coûteuses ont été systématiquement remises en cause. Visiblement, la mécanique de la concession politique à la rigueur économique reprenait son fonctionnement.
Trois décisions majeures ont illustré la « nouvelle » politique économique du gouvernement : l’arrêt du processus d’autonomisation des entreprises publiques et la prise en charge directement par l’Etat du paiement des salaires de plusieurs entreprises telles que celles du BTP; la remise en cause, dans le cadre de la Loi de finance complémentaire de 1991, de la libre installation des concessionnaires et grossistes étrangers; la relance de la politique d’importation et enfin, la diminution des prérogatives de la Banque d’Algérie par le transfert de la décision d’agrément des investisseurs étranger, vers le ministère des Finances.
Les conséquences de ce revirement brutal de l’orientation de la politique économique sur l’appareil productif, notamment le secteur public, furent chaotiques. L’incertitude, l’incompréhension, et surtout le manque d’objectifs et de projet économique clairs, ont provoqué la paralysie totale du système de gestion. Les gestionnaires des entreprises publiques et des fonds de participation, ne sachant plus quels étaient leurs nouveaux statuts, préférèrent gérer les affaires courantes, négocier le paiement des salaires par le gouvernement et ….attendre. En l’espace de quelques mois, la dynamique provoquée par les chantiers de la réforme s’estompa. L’attentisme et la passivité s’érigèrent en mode de gestion par excellence.
Cependant, le gel des réformes, l’attentisme et la passivité n’empêchèrent pas la situation économique de se dégrader, les conditions sociales de la population de se détériorer, et la dette extérieure de s’amplifier. Face à ces épineux problèmes le gouvernement trouve la parade ; le retour à l’ère bénie des hydrocarbures. Il déclare devant l’assemblée nationale « s’il faut, je suis prêt à vendre 20 à 25 % de Hassi Messaoud et je reviendrai vous voir pour cela. Qu’est ce que Hassi Messaoud à côté de l’avenir de mon pays ? À quoi servirait cette richesse si je m’interdisais de l’utiliser pour sauver l’économie nationale, pour épargner la souffrance à mon peuple et préserver son avenir » . Encore une fois, la solution « miracle » ressurgit pour éviter les réformes économiques douloureuses : la rente pétrolière et tout ce qu’elle suppose comme facilités de gestion.
En effet, une nouvelle loi sur les hydrocarbures fut élaborée. Elle permit, pour la première fois dans l’histoire du pays, aux sociétés étrangères de participer à l’exploitation et à l’exportation des gisements pétroliers, y compris ceux qui étaient déjà en production. En contrepartie, les sociétés devaient s’acquitter d’un droit d’entrée. Le gouvernement estimait que l’apport de cette ouverture au capital étranger dans le domaine pétrolier serait d’environ 6 ou 7 milliards $ avant la fin de l’année 1991. Dans le même objectif, le gouvernement envisagea de réactiver le plan gazier « VALHYD », conçu dans les années 1970 mais abandonné par Chadli dans les années 1980. Ce plan visait l’augmentation des capacités d’exportation algérienne en gaz naturel. Visiblement, le gouvernement était à la recherche de l’argent frais.
Entre temps, le premier tour des élections législatives « propres et honnêtes » – principale mission du gouvernement- eut lieu le 27 décembre 1991, le deuxième tour étant prévu pour le 16 janvier 1992. Le résultat des urnes donnèrent au FIS la majorité des sièges, suivi du FFS puis du FLN. Une nouvelle fois, l’armée intervint, annula les élections et démit le Président de ses fonctions. Après le coup d’Etat économique contre les réformateurs, l’armée commît un coup d’Etat politique contre le résultat des urnes. Une violence inouïe se déchaina-elle perdure jusqu’à ce jour. Ainsi, la double transition politique et économique engagée après les évènements d’Octobre, s’acheva dans le sang.
Avec l’arrêt du processus démocratique en 1992, et la « démission » de Chadli, le pays se trouva devant un vide institutionnel quasi-total ; aucune institution n’était en place. La création d’une institution ex-nihilo -car jamais prévue par la constitution- le Haut Comité d’Etat (HCE) fut décidée. Ce dernier prenait la forme d’une instance présidentielle collégiale composée de cinq membres. Elle était présidée dans un premier temps par M. Boudiaf. Figure historique du mouvement national, opposant au régime depuis 1962 et condamné à mort, il avait fui l’Algérie et s’était réfugié au Maroc depuis en 1963. Il accepta cette responsabilité car il estimait que le pays était en danger. Il fut assassiné, au cours d’un meeting transmis en direct à la télévision algérienne, le 29 juin1992.
En janvier 1992, la mission du gouvernement de S.A. GHozali – chargé auparavant de préparer des élections « propres et honnêtes » mais qui seront annulées- était prolongée ! Il continuait sa mission ! Mais sur le plan économique, aucune action d’envergure ne fut entamée. Le gouvernement se contentait de gérer les affaires courantes, avec la prise en charge par l’Etat des problèmes socio-économiques de la population. Le soutien étatique des prix était maintenu, le paiement des salaires des EPE déficitaires était assuré directement par l’Etat…Le retour à l’économie distributive était redevenu une option stratégique, notamment du fait de la dégradation accélérée de la situation sécuritaire. Cette dernière était d’ailleurs devenue la principale préoccupation des pouvoirs publics reléguant au second plan les questions économiques.
La mission du gouvernement de S.A. Ghozali étant arrivée à son terme, il fut remplacé par B. Abdeslam début juillet 1992. Ainsi, l’histoire du gouvernement Ghozali est associée à la remise en cause totale de la double transition vers la démocratie et le marché entamé au lendemain des évènements d’octobre 1988. Elle est aussi synonyme de graves évènements politiques ouvrant la porte à une période de violence extrême qui dure jusqu’à aujourd’hui.
Les conclusions qui se dégagent peuvent être résumées en trois points par ordre d’importance :
Le premier est relatif au degré d’adhésion de l’acteur le plus influent du champ politique algérien, à savoir l’armée, au projet des réformateurs. À postériori, il parait en effet clairement que l’armée n’a jamais été totalement favorable au processus d’ouverture politique et économique initiés au lendemain des évènements d’Octobre 1988. Elle n’envisageait les réformes que comme des réaménagements techniques qui relanceraient le processus de développement, tout en lui permettant de garder sa place hégémonique sur le champ politique.
Or, la dynamique libérée par les réformes institutionnelles et économiques du gouvernement de M.Hamrouche, imposaient la redistribution du pouvoir au sein de l’Etat, et entre ce dernier et la société. Paniquée devant la perspective de la perte de son contrôle sur l’évolution politique du pays, l’armée, à travers les services de sécurités, est intervenue et stoppa nettement l’expérience des réformateurs.
Le second point, qui mérite d’être souligné, est relatif au poids des intérêts matériels des nationaux et des étrangers qui découlaient directement de l’économie administrée. Après analyse, il est permis de conclure que, finalement, le sous-développement de l’économie algérienne et sa dépendance viscérale de la rente pétrolière, est une aubaine pour plusieurs groupes sociaux à l’intérieur et à l’extérieur du pays. Ces derniers préfèrent le captage de la rente pétrolière distribuée par l’Etat pour des raisons politiques, que de se recycler dans le cadre d’une économie productive régie par les lois du marché à travers la concurrence et la vérité des prix. Ils se sont opposés systématiquement à tout projet de réformes visant le démantèlement des mécanismes rentiers de l’économie administrée.
Le troisième et dernier point a trait au programme des réformateurs et à sa gestion par le gouvernement de M.Hamrouche durant ses 23 mois d’exercice.
Le programme est, malgré ses imperfections (absence d’une politique industrielle, hésitation à privatiser les entreprises déficitaires…) cohérent. Cependant, il semble que le gouvernement, tout en sous-estimant le degré d’opposition que ses réformes pouvaient susciter, surestimait le niveau d’adhésion de la population à son projet.
En ce qui concerne le premier point, il est important de rappeler que, lors de sa désignation, le gouvernement de M.Hamrouche avait le soutien du Président, et il avait négocié et obtenu les pleins pouvoirs, mais n’a pas profité de la faiblesse du régime pour imposer des institutions de transition. Il a continué à fonctionner avec la même assemblée détenue par le parti unique et avec le même personnel administratif, notamment au sein des directions centrales, des institutions économiques et des entreprises publiques. Les seuls changements visibles qu’il a apportés concernaient le choix de son équipe. Ce qui s’est avéré largement insuffisant eu égard l’ampleur des changements qu’il voulait mettre en œuvre. Résultat : les plus importants blocages des réformes étaient le fait du personnel administratif en place (banquiers, chefs d’entreprises…), ceux là même qui devaient impulser la dynamique de réformes au niveau méso et micro-économiques.
D’autre part, il nous semble que le gouvernement avait surestimé sa capacité à susciter l’adhésion de la population à son projet. Les réformateurs semblaient ignorer l’ampleur de la défiance de la population, et son rejet pour tout ce qui provient du régime politique en place, que Hamrouche incarnait malgré lui. Plus de trois décennies de fausses promesses et de duperies, de la part d’un personnel politique ayant privatisé l’Etat dans l’unique objectif d’accumuler les richesses économiques, avaient suffit pour que la population s’inscrive dans la dissidence, la rébellion ou l’apathie. C’est la raison pour laquelle le gouvernement réformateur n’a pas suscité l’engouement, ni la dynamique populaire qu’il souhaitait afin de contrecarrer ses adversaires au sein du pouvoir d’Etat.
Par Mourad OUCHICHI, de l’École doctorale option Sciences sociales à l’université Lumière Lyon 2
- CRB - PAC : Une place de dauphin en jeu pour le Chabab
- Mikhail Bogdanov reçu par Tebboune : L’Algérie et la Russie consolident leurs relations
- Après les viandes et les poissons : Y-a-t-il une spéculation sur les prix du café ?
- CSC - Le rêve grandissant des Sanafir en coupe : L’appétit vient en mangeant
- CSC - Le rêve grandissant des Sanafir en coupe : L’appétit vient en mangeant
- ESS : Prêts pour la JSS
- Suite à la riposte iranienne: La Malaisie appelle à une désescalade au Moyen-Orient
- Appel à participation au colloque sur les transformations du théâtre en Afrique à l’ère des médias
- Education nationale : Les orientations de Belabed pour le 3e trimestre
- Rumeurs sur une révision de l’allocation chômage: La Présidence dément
- USMA - Après sa brillante qualification pour les ¼ finale : Cap sur l’US Biskra
- ESS : L’Entente met le paquet pour Chetti et Draoui
Infos régionales

Annuaire des sites algériens
Autres sites
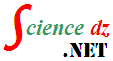
Le site des sciences en Algérie
Vous cherchez un emploi? Essayer la recherche d'emploi en Algérie
 Babalweb Annonces
Babalweb AnnoncesPetites annonces gratuites
