Abdelaziz Rahabi. Ancien ministre de la Culture et de la Communication
«Il ne faut pas que le problème de Bouteflika devienne celui de l’Algérie»

Trouvez-vous normal que l’élection présidentielle soit évacuée du débat national, alors que trois mois nous séparent de l’échéance ? Que se passe-t-il dans la maison du pouvoir ?
En fait, les Algériens découvrent la présidence à vie et ses conséquences. Depuis Ben Youcef, le premier Président, la question des pouvoirs s’est posée avec une violente acuité en raison du caractère éminemment présidentialiste de nos Constitutions.
C’est l’incapacité d’un président de la République qui se pose pour la première fois dans l’histoire de l’Algérie.
Alors que partout dans le monde on a évolué vers l’équilibre des pouvoirs, chez nous les décideurs croient encore que la meilleure façon de gouverner est de museler la libre expression, de contrôler la justice et de distribuer la rente.
Vous évoquez souvent des groupes d’intérêts non institutionnels qui pousseraient vers le report de la présidentielle. Pourquoi et qui sont-ils ?
Ils ont toujours existé dans des formes différentes en raison de la nature des systèmes économiques. Dans les années 1970, le socialisme avait ses capitalistes bureaucratiques et sa bourgeoisie compradore, certes moins visibles, mais aussi influents que les groupes d’intérêts qui se sont constitués ces trois dernières décennies. Ceci n’est donc pas nouveau. Ce qui l’est par contre, c’est l’engagement politique peu discret de certains groupes d’intérêts économique et autres tentés de se substituer aux pouvoirs publics. Cette confusion n’est bonne ni pour les hommes d’affaires ni pour l’Etat.
Les différents groupes constitutifs du pouvoir sont-ils d’accord pour la non-tenue de l’élection présidentielle dans ses délais ?
Ce n’est pas aussi facile ni aussi simple, car dans les traditions du système algérien, les décisions se prennent de façon concertée et solidaire, en tenant compte de paramètres durables et stabilisants. A ce titre, il n’est pas évident que ceux qui donnent l’impression d’avoir le pouvoir réel aujourd’hui soient consultés pour l’après-Bouteflika. L’Etat sait reprendre ses pouvoirs dans les situations de crise, parce que conscient qu’il est la seule forme d’organisation pérenne.
Pensez-vous qu’une révision de la Constitution puisse avoir lieu avant avril 2019 ?
Dans la tradition du système algérien, une telle démarche est collégialement adoptée pour éviter d’aggraver la crise. Je ne crois pas que cela fasse consensus en ce moment, ni au sein de la classe politique, y compris au sein de la coalition, ni au sein du commandement de l’armée en raison de ses implications sur la stabilité, donc de l’ordre public. De même que socialement, les nouveaux acteurs comme les réseaux sociaux ne semblent pas favorables à cette aventure. Il ne faut pas que le problème de Bouteflika devienne celui de l’Algérie.
Comment le système est-il parvenu à cette impasse ? Bouteflika n’a-t-il pas pensé à préparer sa sortie ?
Le président à vie n’accepte aucune contestation de son pouvoir. Il œuvre à neutraliser toute forme de velléité de lui succéder et empêcher ainsi l’émergence de nouvelles élites politiques. Le cas de l’Algérie de Bouteflika est symptomatique.
En fait, les Algériens découvrent avec lui la présidence à vie dans laquelle nous sommes entrés à contre-courant de l’histoire, alors qu’elle a été exercée par Moubarek, Ben Ali, El Gueddafi et même en Europe avec l’Espagne de Franco.
Et tout le monde connaît ce que ce type de régime politique a eu comme conséquences. Chez nous, seul Liamine Zéroual avait la générosité et la vision pour nous éviter cette situation en limitant, dans la Constitution de 1996, la Présidence à deux mandats uniquement.
Ne pensez-vous pas que cette situation pèse lourdement aussi sur la famille du Président, à qui on attribue beaucoup de pouvoir ? N’est-elle pas finalement elle-même otage de ce système ?
C’était prévisible. Le Président est sensible au système politique du makhzen dont la nature diffère de celle du régime algérien en raison des parcours historiques différents de chacun des deux pays. Ainsi, le palais présidentiel, réduit à sa simple expression ces dernières années, s’est substitué aux institutions pour contrôler dans le moindre détail la distribution de la rente et la gestion des carrières administrative, politique et militaire. Apparemment, c’est suffisant pour diriger un pays aussi complexe que l’Algérie.
Ce qui choque le plus, c’est la vitesse à laquelle le système global algérien s’est accommodé de ce mode de gouvernement dans lequel la figure du Président – absent – est sacralisée et son entourage installé dans une sorte de délégation de pouvoirs par omission. Ceci est d’ailleurs un instrument de mesure des archaïsmes nous renseignant sur le retard pris dans la construction d’un Etat moderne.
Face à toutes ces inquiétudes, comment l’institution militaire réagira-t-elle, selon vous ?
Le commandement de l’armée n’a pas été par le passé un élément de promotion de la démocratie en Algérie, particulièrement celui issu de la Guerre de Libération. L’équation sécuritaire est peut-être la matrice de cette attitude en raison du traumatisme de la Guerre de Libération et des leçons de la crise sécuritaire et politique des années 1990, mais n’est pas l’otage de cette situation et semble envisager avec sérénité sa professionnalisation, le rajeunissement de son commandement et l’adaptation aux nouvelles menaces. C’est cela qui renforce le lien avec le peuple, bien plus que l’implication dans le débat politique.
La responsabilité incombe également aux politiques qui, par manque de courage ou de vision, appellent l’armée à s’impliquer, participant ainsi à la fragilisation du consensus national dont elle doit bénéficier pour mener à bien ses missions constitutionnelles.
Comment sortir de cette impasse ?
Certainement pas en cherchant un subterfuge comme la révision de la Constitution ou en appelant à une conférence nationale sur le modèle de l’Afrique subsaharienne des années 1990. Ce modèle de conférence comporte un double risque. Si elle est souveraine, elle relèvera davantage l’incapacité de Abdelaziz Bouteflika. Si elle ne l’est pas, elle perdra toute forme de crédibilité et son échec aggravera la crise. Je pense que ces recettes de dernier quart d’heure, inconsistantes et irresponsables, participent à la mise en place d’une atmosphère malsaine qui procède de la politique de la terre brûlée.
Selon vous, qui êtes diplomate de carrière, comment réagiraient les partenaires de l’Algérie en cas de non-respect de l’ordre constitutionnel ?
En Algérie, nous avons tendance à beaucoup prêter aux étrangers, soit pour trouver un bouc émissaire ou bien pour nous décharger sur nos partenaires. C’est aussi malsain qu’indigne d’essayer de rallier les diplomates étrangers avant son propre peuple et de s’en vanter sans vergogne. Dans le monde aujourd’hui, toute évolution positive ou négative a des conséquences sur le voisin ou le partenaire qui doit donc anticiper, s’adapter ou encore orienter quand cela est possible. Le monde est ainsi fait. Cela ne dépend que de nous et de l’adhésion de notre peuple à ce que nous proposons ou entreprenons. Il reste que la crédibilité et la visibilité ne sont pas les plus fortes qualités de nos dirigeants.
Quelles seraient les conséquences politiques et géopolitiques en cas de non-respect de l’agenda électoral ?
Je ne crois pas personnellement à une telle perspective. Il est vrai que nous ne sommes pas suffisamment mondialisés, mais nous devons tenir compte du fait que l’exception algérienne dans la région doit cesser. Et c’est dans notre propre intérêt avant celui des étrangers. Une Algérie plus juste et plus forte est avant tout une exigence interne.
- La déclaration de devises étrangères à l'entrée et à la sortie du territoire national
- Inauguration d'une usine de pièces automobiles et d'une unité de production de batteries
- CRB - PAC : Une place de dauphin en jeu pour le Chabab
- Mikhail Bogdanov reçu par Tebboune : L’Algérie et la Russie consolident leurs relations
- Après les viandes et les poissons : Y-a-t-il une spéculation sur les prix du café ?
- CSC - Le rêve grandissant des Sanafir en coupe : L’appétit vient en mangeant
- CSC - Le rêve grandissant des Sanafir en coupe : L’appétit vient en mangeant
- ESS : Prêts pour la JSS
- Suite à la riposte iranienne: La Malaisie appelle à une désescalade au Moyen-Orient
- Appel à participation au colloque sur les transformations du théâtre en Afrique à l’ère des médias
- Education nationale : Les orientations de Belabed pour le 3e trimestre
- Rumeurs sur une révision de l’allocation chômage: La Présidence dément
Infos régionales

Annuaire des sites algériens
Autres sites
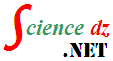
Le site des sciences en Algérie
Vous cherchez un emploi? Essayer la recherche d'emploi en Algérie
 Babalweb Annonces
Babalweb AnnoncesPetites annonces gratuites
