Décryptage. Comment le soutien international permet au régime algérien de survivre à toutes ses crises

Au vu de la dimension économique, l’Algérie peut être considérée comme un pays dont le socialisme, bien que de façade, était assez bien intégré dans l’économie mondiale grâce à la présence d’une ressource économique bien particulière : les hydrocarbures. Ses recettes gazières et pétrolières lui permettant des politiques distributives (Aissaoui, 2001), l’Algérie dépend de l’économie internationale, dans le sens où les fluctuations du marché des hydrocarbures ont une influence significative, non seulement, sur les revenus générés mais aussi sur les luttes politiques inévitablement suscitées lors de leur distribution (Beblawi, Luciani, 1987).
Par ailleurs, les clients de l’Algérie – pays développés, investisseurs étrangers et multinationales – qui lui achètent son pétrole et son gaz considèrent comme un intérêt « national » la sécurisation de leurs approvisionnements.
Les revenus des hydrocarbures aident les élites dirigeantes à gérer la dissidence par une redistribution partielle des recettes. Cependant, la rente a un défaut majeur : les recettes utilisées pour apaiser créent dans le même temps un mécontentement chez ceux qui n’en bénéficient pas ou moins que d’autres. Ainsi, la rente fonctionne dans deux sens : en générant du mécontentement vis-à-vis du régime et/ou en le renforçant. Il existe cependant chez certains auteurs une tendance à généraliser la rente comme seule explication à tout ce qui se passe dans la région, tant au plan politique qu’économique, en négligeant les autres facteurs (Talahite, 2006).
En relation avec son importance géostratégique, l’Algérie a constitué à plusieurs reprises ce que Quandt (1998b) a nommé un État « pivot » pour les puissances mondiales du fait de sa localisation géographique au cœur de la Méditerranée, de son histoire anticoloniale et de son appartenance au monde arabe au sens large. Son rôle de fournisseur de gaz et de pétrole amplifie son importance pour toute l’Europe du Sud, ainsi que pour les États-Unis.
Trois chocs externes
On peut essayer de retracer, de manière certes très simplifiée, selon les trois variables – chocs externes, politiques directes et esprit du temps – et à partir d’observations de terrain, la manière dont les acteurs nationaux réagissent face aux stimulations externes. Les principaux acteurs de la politique algérienne sont les services de sécurité, les élites politiques, l’opposition islamiste et les partis dits « démocratiques ». Ils ont tendance à entrer en compétition les uns avec les autres mais il existe aussi une compétition interne à chaque groupe. L’« international » structure les incitations et les opportunités pour chacun des groupes et sous-groupes, en offrant ou retirant des ressources, à la fois matérielles et morales, qui sont utilisées dans le jeu interne et peuvent en déterminer la victoire ou la défaite politique.
Des chocs externes ont eu un impact sur les politiques algériennes de ces trois dernières décennies. Tout d’abord, la récession mondiale ayant entraîné la chute de la valeur du dollar ainsi que le contre-choc pétrolier de 1986 ont contribué à une réévaluation de l’ensemble de l’architecture de l’économie algérienne en minant le pacte entre État et citoyens basé sur la redistribution, même inégale, de la rente pétrolière. La chute brutale des revenus du gaz et du pétrole a eu un impact très fort sur la capacité de l’État à maintenir son engagement en faveur de l’emploi et des interventions publiques sous forme de subventions à la consommation, permettant aux réformateurs favorables au marché et hostiles aux choix économiques du passé des percées politiques à l’intérieur même du régime. Le désastre économique de la « seconde » moitié des années 1980 fut ainsi la principale cause des émeutes d’octobre 1988, moment critique à l’origine des tentatives de changements de régime qui suivront. La grave situation économique a eu comme effet un repositionnement de sous-groupes à l’intérieur du régime et l’émergence de divisions apparentes. Alors qu’il existait auparavant une unité de façade des élites dirigeantes, les divergences apparues dans la réaction face aux révoltes déterminèrent largement le positionnement de chacun dans les événements qui allaient suivre. Les réformateurs, avec à leur tête Hamrouche et Hidouci, œuvraient pour un changement d’orientation économique et, à la faveur de la récession qui commence en 1986, une opportunité s’ouvrit pour un autre modèle de développement. Certaines réformes, comme l’abandon de la collectivisation agricole, la réintroduction du droit à la propriété privée de la terre et l’assouplissement de la réglementation en matière d’autorisations d’importation et d’exportation, sont antérieures à 1989 alors que l’on ne parlait pas encore de pluralisme politique.
La portée limitée de ces premières réformes ne doit pas minimiser leur importance politique qui révèle une volonté de la part des réformateurs de réaliser la transformation rapide de l’économie algérienne. Les réformes s’accélérèrent après février 1989 avec l’élimination de subventions aux biens alimentaires, l’autonomie de la banque centrale, la libéralisation partielle des investissements étrangers et une nouvelle législation concernant le crédit et la monnaie (Corm, 1993). L’avènement du pluralisme politique et la poursuite des réformes économiques bénéficia à l’Islam politique dont le message trouva une large audience auprès des déçus du régime (Addi, 1992). Le FIS devint le principal bénéficiaire de la grave situation économique mal gérée par les élites au pouvoir, dont il dénonça le caractère illégitime en s’en servant comme argument idéologique. Abassi Madani déclara : « l’État algérien de 1962 ne correspond en aucun point à celui rêvé le 1er novembre 1954, quand nous avons pris les armes pour le créer : un État indépendant basé sur les principes islamiques » (Zéghidour, 1990, p. 180). Ainsi, si la crise mondiale et ses répercussions sur l’économie algérienne mirent à nu les défaillances du système économique, elle permit l’émergence de certains acteurs politiques disposant de ressources qu’ils pouvaient utiliser dans la lutte politique. Inversement, la hausse progressive des prix du pétrole après 2000 permit à l’Algérie de revenir progressivement aux politiques de redistribution du passé et d’accéder à un rôle plus important dans les affaires internationales.
Le deuxième choc, qui eut des répercussions importantes en Algérie, fut la fin de la guerre froide, qui se produisit au moment où le pays était au plus fort de la crise économique.
Le démantèlement rapide des économies des pays socialistes obligea les élites dirigeantes algériennes à trouver un discours de substitution au socialisme pour s’intégrer au nouvel ordre économique et politique, construit autour du système unipolaire états-unien et des valeurs qui lui sont attachées (droits de l’homme, démocratie, économie de marché). Il serait toutefois trop réducteur de considérer cela comme la seule raison de la reconfiguration du système politique algérien, le rapprochement avec les États-Unis ayant commencé au milieu des années 1980 (Ait-Challal, 2000). La première étape fut la visite en Algérie du vice-président George Bush en septembre 1983. « Après cette visite, les relations entre les deux pays s’intensifièrent et les rencontres se multiplièrent » (Aït-Challal, 2000, p. 171). Notons que la quête de meilleures relations avec les États-Unis venait principalement d’Alger.
Si les États-Unis avaient été plus actifs dans leur soutien à Chadli, ce rapprochement aurait été vu comme une tentative américaine de gagner davantage d’influence, mais le fait que les initiatives diplomatiques ne venaient que d’Alger indique une réelle volonté de se séparer de l’influence soviétique. Ce ne fut pas un choix libre mais contraint, dont l’objectif était de s’adapter à un nouvel ordre international qui ne tournerait désormais qu’autour des États-Unis. Une autre preuve de l’alignement de l’Algérie sur le vainqueur de la guerre froide est la diversification de ses fournisseurs d’armes à partir de 1985, l’Algérie étant particulièrement « intéressée à étendre ses relations militaires avec les États-Unis » (Bennet, 1985, p. 759). Les discours du président Chadli s’éloignèrent de la rhétorique socialiste du passé, son équipe de réformateurs se rapprocha idéologiquement du Fonds monétaire international en « faisant du FMI sans le FMI » (Jeune Afrique, 1ermars 1989) et ses réformes politiques furent appréciées si ce n’est encouragées par le président français François Mitterrand et par les États-Unis. Ce rapprochement apporta un premier soutien occidental aux efforts de libéralisation de Chadli après février 1989. Comme le souligne Ruf (1997, p. 9), « après la chute brutale des revenus du pétrole en 1986-1987, la communauté bancaire internationale a approuvé le crédit à l’Algérie soumis à l’approbation du FMI, qui devient automatiquement et inévitablement le partenaire pour les négociations ». Cette situation donna des ressources de légitimité considérables au FIS, qui joua dès lors la carte classique de l’anti-impérialisme arabo-musulman. Abassi Madani philosopha ainsi sur la démocratie et le libéralisme occidentaux :
« La démocratie américaine, dans son sens libéral et pragmatique, a confirmé les libertés mais elle a donné aussi plus de droits individuels aux dépens du groupe. Elle a donné plus de droits aux riches qu’aux pauvres. C’est cette liberté qui coûte à la justice économique et sociale… La démocratie dans son sens marxiste, d’un autre côté, restreint les libertés… L’alternative islamique offre le genre de libertés où libertés individuelles et sociétales ne s’opposent pas » (Shahin, 1997, p. 226).
Cette position critique de la pratique démocratique américaine – perçue en Occident comme anti-occidentale – est apparue lors de la guerre du Golfe (1990-1991), quand le FIS bénéficia sur le plan interne de la radicalisation de son discours anti-américain contre la coalition internationale combattant en Irak. Cela augmenta son potentiel de crédibilité à l’intérieur du pays qu’il utilisa contre le régime, indiquant sa capacité à internaliser des événements externes. Le régime devint de moins en moins populaire car il refusa de soutenir pleinement Saddam Hussein. Par ailleurs, la guerre du Golfe de 1990-1991 révéla à la France et aux États-Unis que les citoyens dans le monde arabe désapprouvaient le « nouvel ordre mondial », ce qui les poussa à changer de diplomatie dans la région et à retirer leur soutien aux forces démocratiques au profit de la consolidation des régimes autoritaires.
Le troisième choc qui ébranla l’Algérie fut le 11 septembre 2001. Il eut pour résultat de mettre les élites dirigeantes sur le devant de la scène et permit leur réintégration complète dans la communauté internationale. En déclarant que le monde « civilisé » était confronté au même ennemi, elles offrirent leur expertise dans la lutte antiterroriste, ce qui permettait de légitimer leurs propres actions antiterroristes et anti-islamistes passées. Les ressources matérielles et en légitimité externe engrangées par le régime durant ces dix dernières années ont certainement renforcé les cercles dirigeants. Le pays a bénéficié d’avantages politiques et économiques et n’a pas été stigmatisé comme « État voyou ». Notons cependant que ce soutien ne résulte pas du 11 septembre, il commença avec l’annulation des élections législatives de 1992 et le coup d’État militaire qui suivit. Les « récompenses » reçues alors peuvent être classées en trois catégories. La première, financière et économique, inclut assistance et investissements étrangers dans le secteur des hydrocarbures, et la participation à des accords multilatéraux.
Volpi (2003, p. 114) compte qu’« entre la fin de 1993 et le début 1995, le régime algérien a pu bénéficier d’au moins 15 milliards de dollars à travers le rééchelonnement de la dette et des crédits de la part de gouvernements occidentaux, banques et organisations financières internationales. » Les investissements étrangers furent particulièrement décisifs au début des années 1990 (Martinez, 1998) pour soutenir le régime contre les insurrections. La deuxième, de nature politique, est la légitimation internationale du régime politique et de ses successeurs au milieu des années 1990. L’Algérie fut enfin admise dans les forums internationaux et les partenariats multilatéraux sans avoir à montrer ses galons démocratiques et, vers le début du nouveau millénaire, elle devint un partenaire indispensable dans la région. La troisième catégorie concerne la sécurité. Dès le début du conflit civil en 1992, la communauté internationale se mit à penser qu’une Algérie « stable » pouvait être un des piliers de la structure sécuritaire régionale. Elle est, par exemple, l’un des sept pays impliqués dans le « Dialogue méditerranéen » lancé par l’OTAN en 1994 dans le but d’améliorer la stabilité sécuritaire régionale. En somme, les chocs externes ont particulièrement pesé dans les calculs et les ressources des acteurs nationaux qui ont essayé de trouver un nouvel équilibre social et institutionnel après les manifestations de 1988 et la libéralisation avortée du début des années 1990.
Les réseaux français et américains
Les politiques directes de l’État et des acteurs non étatiques depuis la fin des années 1980 ont été conçues à travers le prisme de l’interprétation des chocs externes. L’enthousiasme originel des pays occidentaux pour la libéralisation et la démocratisation se transforma en mécontentement à partir du moment où ces processus leur semblèrent plus profiter à ce qu’ils appelaient des forces antilibérales, anti-démocratiques et anti-occidentales. Ce fut d’ailleurs plus le cas de la France que des États-Unis, ces derniers n’étant pas encore concernés par les islamistes algériens et ce du moins jusqu’à la fin de la Guerre du Golfe, lorsque le niveau d’hostilité anti-américain devint plus manifeste et que le Secrétaire d’État James Baker III, revenant de son enthousiasme pour la vague démocratique, tenta de sécuriser la survie du régime algérien (Baker III, 1994).
Le cas français est très différent. Utilisant un réseau déjà bien rôdé de relations franco-algériennes (Aggoun, Rivoire, 2004), ce pays a soutenu activement le régime sorti du coup d’État de 1992. Certains supposent même qu’il l’encouragea ouvertement : le coup d’État fut conçu par « un certain nombre d’officiers de hauts rangs de l’armée algérienne [qui] venaient des rangs de l’armée française : notamment pour ce qui est de Mohammed Lamari, Mohammed Touati, Larbi Belkheir et Khaled Nezzar » (Zirem, 2002, p. 106). Preuve de ce soutien, « lors du sommet européen de Luxembourg en juin 1991, [la France] fit placer l’Algérie en premier dans l’agenda. Sans aucune hésitation, le Conseil décida d’accorder au président Chadli une aide financière d’environ 400 millions d’écus » (Morisse-Schlibach, 1999, p. 52) – ce qu’il avait auparavant refusé au gouvernement réformateur de Hamrouche – pour l’aider à combattre le FIS.
Ce soutien français fut une épée de Damoclès pour le régime car, tout en augmentant ses ressources matérielles, il en affaiblissait la légitimité en générant le label de « parti de la France » accolé par les opposants au régime. La France ne se sentit confortée dans ce rôle que lorsque la « décennie noire » tira sur sa fin et que le régime se stabilisa. Elle continua de privilégier ses relations, souvent difficiles, avec l’Algérie, et ne reprocha jamais au régime d’avoir tué le processus démocratique dans l’œuf et de s’être recyclé sans avoir introduit un réel pluralisme politique.
Cette menace islamiste ne semble plus considérée aujourd’hui comme aussi forte par la France, si l’on en croit l’ouverture, bien que conditionnelle, aux islamistes tunisiens vainqueurs des élections d’octobre 2011.
Mais l’idée de vraies réformes démocratiques au Maghreb provoque toujours une réaction négative dans les cercles politiques français, du fait du degré d’incertitude lié à ce qu’elles apporteraient et de la possibilité d’un impact négatif sur les intérêts français et leurs réseaux de clientèle. Signalons que c’est là que résident l’incohérence et parfois même l’hypocrisie des démocraties occidentales.
Ce n’est ni la question de l’Islam politique comme source locale de légitimité, ni même celle du possible déficit démocratique et en matière de droits de l’homme dans les politiques nationales menées par les islamistes qui posent problème aux États-Unis, à la France et aux autres pays occidentaux. Comme l’attestent de nombreux éléments tels que le soutien des occidentaux à l’Arabie Saoudite et la façon dont ils ont tout accepté aveuglément de ce pays, depuis son aide aux groupes extrémistes islamiques dans la guerre URSS-Afghanistan (Cooley, 2002). Ce sont le remplacement d’élites avec lesquelles il a tissé des liens étroits basés sur des intérêts économiques et politiques mutuels, et les conséquences négatives que cela pourrait avoir qui déterminent le soutien parfois aveugle de l’Occident aux élites au pouvoir, plutôt que la nature du remplaçant potentiel : la stabilité avant tout. Ainsi les élites dirigeantes et les Forces armées algériennes obtinrent une aide directe et indirecte considérable en armes (Souaidia, 2002), soutiens politique – comme l’admission de l’Algérie au partenariat euro-méditerranéen – et médiatique (Slisli, 2001) dans leur guerre militaire et idéologique contre les islamistes, non pas tant parce que le FIS était islamiste, mais surtout à cause des changements de politique étrangère qu’il aurait pu opérer et de sa détermination à rompre la relation, durable et profitable, entre l’Algérie et les élites occidentales, notamment françaises.
Un changement radical dans le système politique et donc dans le gouvernement aurait bouleversé ces liens et aurait eu des répercussions économiques. Les réseaux diplomatiques et économiques américains et, surtout, français n’avaient pas envie de se jeter dans l’inconnu. Ce point est doublement important : il met en évidence le rôle crucial des positions prises dans le cadre de leur politique étrangère par les acteurs émergents dans les pays en voie de démocratisation ; il suggère que l’analyse de la transition en termes de structure ouverte peut être appliquée plus généralement, au-delà du cas des pays arabes et des mouvements islamistes.
Les démocraties occidentales ont des intérêts globaux, pas forcément légitimes ni éthiques, qu’elles ne veulent pas voir remis en cause, peu importe que la menace vienne des chavistas vénézuéliens ou des militants barbus algériens. Même si la défaite de l’islamisme en Algérie n’est pas entièrement le produit d’interférences externes, il faut bien reconnaître que les ressources externes accessibles aux élites dirigeantes ont joué un rôle important dans la configuration de ce qu’est l’Algérie aujourd’hui.
Durant la présidence de Bouteflika, l’Algérie a consolidé sa place dans la communauté internationale, bien que le caractère autoritaire du régime soit patent. Par exemple, quand Bouteflika fut réélu en 2004, la Maison Blanche déclara : « le Président félicite le Président Bouteflika pour sa réélection. Ces élections représentent une nouvelle étape vers la démocratie algérienne ». Un message identique fut émis par Paris.
La dimension internationale ne se limite pas aux politiques occidentales. Depuis la fin des années 1980, l’Islam politique en Algérie a bénéficié des politiques étrangères de l’Iran et de l’Arabie Saoudite qui ont contribué de manière importante à la cause islamiste algérienne. L’Iran, de manière indirecte, montrait comment on pouvait battre un pouvoir illégitime. Même si cela pouvait ne pas correspondre exactement au contexte, il y a eu certainement un souffle d’inspiration pour tous ceux qui combattaient un régime injuste. Selon certains (Kepel, 2000), l’Arabie Saoudite est intervenue de manière plus directe en finançant de nombreuses activités du FIS, bien que ce dernier n’ait jamais admis avoir reçu de fonds saoudiens. De plus, l’islamisme algérien plus radical, en particulier après l’annulation des élections de 1991, a bénéficié du savoir-faire et de l’expérience des Algériens s’étant battus en Afghanistan dans la guerre contre l’URSS. Cela donna l’occasion au régime et à l’Occident d’accuser le FIS d’être manipulé de l’extérieur.
Aujourd’hui, la situation internationale a beaucoup changé, de même que l’Islam politique, qui est devenu moins doctrinaire et qui reprend désormais à son compte le discours de démocratisation « mondialisée » et des droits de l’homme contre le régime, peut-être en l’instrumentalisant. L’islamisme algérien, même s’il semble devenu marginal et soumis au pouvoir (Boubekeur, 2007), est toujours présent et constitue une alternative possible aux arrangements en place. Dans un contexte international mouvant, les différents mouvements islamistes ont appris à intégrer ces changements pour en bénéficier au maximum (Zoubir, Ait-Hamadouche, 2006).
Si les rapports entre l’Islam politique et les élites dirigeantes ne couvrent pas toute la gamme des relations entre les acteurs locaux qui influent sur la scène politique algérienne, ils sont les plus importants d’un point de vue international, expliquent en partie comment les changements sont apparus en Algérie et quelles sont les transformations, à l’échelle nationale et internationale, qui ont orienté le pays vers une paradoxale continuité autoritaire.
Par Francesco Cavatorta; professeur au Département de science politique de l’Université Laval
- CRB - PAC : Une place de dauphin en jeu pour le Chabab
- Mikhail Bogdanov reçu par Tebboune : L’Algérie et la Russie consolident leurs relations
- Après les viandes et les poissons : Y-a-t-il une spéculation sur les prix du café ?
- CSC - Le rêve grandissant des Sanafir en coupe : L’appétit vient en mangeant
- CSC - Le rêve grandissant des Sanafir en coupe : L’appétit vient en mangeant
- ESS : Prêts pour la JSS
- Suite à la riposte iranienne: La Malaisie appelle à une désescalade au Moyen-Orient
- Appel à participation au colloque sur les transformations du théâtre en Afrique à l’ère des médias
- Education nationale : Les orientations de Belabed pour le 3e trimestre
- Rumeurs sur une révision de l’allocation chômage: La Présidence dément
- USMA - Après sa brillante qualification pour les ¼ finale : Cap sur l’US Biskra
- ESS : L’Entente met le paquet pour Chetti et Draoui
Infos régionales

Annuaire des sites algériens
Autres sites
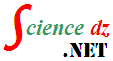
Le site des sciences en Algérie
Vous cherchez un emploi? Essayer la recherche d'emploi en Algérie
 Babalweb Annonces
Babalweb AnnoncesPetites annonces gratuites
