Décryptage. Pourquoi les dirigeants algériens craignent et détestent les intellectuels

Allumer la lumière pour toutes les sociétés, y compris musulmanes puisque Le Livre saint débute par l’emblématique injonction « » (« lis! »), c’est alphabétiser les peuples. Nous allons donc tenter une déconstruction, axée sur l’Algérie, de la manière dont on se sert de la politique dite « d’arabisation ».
On montrera de la sorte que ce qui fut souvent qualifié de « mauvaise arabisation » revenait en réalité à remettre en cause l’existence d’une élite intellectuelle sur place, au bénéfice d’une élite aux ordres d’un islam d’État décrétant ce qui est juste, bon, vrai, ou possible. Il ne s’est pas agi de transmettre le message coranique mais de cloîtrer le champ intellectuel. En Algérie deux formules – autant de promesses – ont rendu possible cet usage du religieux : démocratisation de l’enseignement et politique d’arabisation. Il s’agissait, nous l’entendons dans les termes, de redéfinir ce qui « relie » les êtres et leur confère un caractère national.
Le choix de l’arabisation
Le choix politique de l’arabisation a marqué, dans un premier temps, un moment de déplacement. D’un pays africain confronté à l’oppression coloniale française, l’Algérie s’est trouvée déplacée dans l’aire idéologique et politique du monde arabe, devenu peu à peu arabo-musulman. Les contenus du processus de décolonisation, que ce pays devait vivre avec le reste du Maghreb, s’en trouvaient modifiés. Il ne s’agissait plus de transformer la nature des liens qui l’unissaient à l’ancienne puissance coloniale, mais de repenser son identité propre. Le mal était dans le fruit et non dans l’expérience coloniale. Nous étions coupables de nous être éloignés de nous-mêmes. Pourtant, c’est ce souvenir de Soi qui nous avait permis de résister à l’humiliation coloniale. Peu à peu, la manipulation de la langue arabe fut seule investie de la capacité de produire un être nouveau, arabe, que l’on prétendait lié à une langue marquée du sceau du sacré par la référence à un Livre saint. On niait ainsi d’autres couches de l’identité des berbères africains islamisés, frottés à la culture française durant plus d’un siècle.
Cet être historique et complexe devait céder la place à un arabo-musulman désaliéné, enfin libéré du regard de l’Autre par la seule force du passage de langue. Ce nouvel homme arabo-musulman, adossé pourtant à une grande civilisation, ne parvient pas à naître dans des sociétés où les pouvoirs politiques empêchent les élites intellectuelles d’émerger et entretiennent l’ignorance et la coercition ; il souffre aussi de l’usage immodéré qui est fait de la langue arabe comme vecteur d’une idéologie de la clôture. L’illusion d’une spécificité culturelle et sociale inscrit les sociétés dans un temps vécu comme immuable. C’est ainsi que des pouvoirs autoritaires, confrontés à une forte demande d’éducation, répondent par une approche quantitative, aucune interrogation n’étant permise à propos des contenus.
Le pouvoir algérien, comme nombre de régimes arabes, nourrit cette langue arabe et croit fonder sa légitimité sur de grands récits nationalistes où la résistance à la domination étrangère rejoint la défense de la foi musulmane. Il continue de refuser le débat sur les sociétés présentes et leur fonctionnement. Il se heurte alors à une autre épopée, tout aussi légitimée par le passage de langue : celle du retour par une langue plus pure à des temps plus sacrés, à savoir l’État musulman.
Confronté à une grave crise interne, ce régime continue de négocier un statu quo à travers la manipulation quotidienne de thèmes éculés et en opposant laïcs et islamistes, nationalistes et alliés de l’étranger. La langue est un enjeu autour duquel s’articulent des divisions en termes de francophones et arabophones, d’alliés de la France et de mains de l’étranger… Les affrontements les plus radicaux se vivent pourtant dans la langue arabe même, et opposent les nationalistes aux islamistes. Aucune opposition extérieure à ce binôme ne parvient à produire un récit à usage externe ou interne susceptible d’entraîner les populations. Une industrie des mots comme société civile, démocratisation, corps électoral, citoyenneté, existe mais ne parvient pas à masquer que le vent du sud ne souffle plus. Comment des acteurs de la moitié du XXe siècle sont-ils devenus des hordes que seul le Sacré parvient à mobiliser ? Pourquoi aucun autre discours n’a pu mobiliser les populations ? Répondre à cette question signifie aussi réfléchir sur ce que le recours au Sacré suppose aussi de désenchantement :
Ici, nul « moi ».Ici, Adam se souvient de la poussière de son argile.
Un désenchantement qui nourrit aujourd’hui la langue arabe et nous conduit à nous interroger sur ce que ces sociétés savent d’elles-mêmes et sur la manière dont elles l’expriment. Mais existe-t-il, dans ces sociétés, des conditions pour un autre mode de représentation susceptible d’intégrer un pays comme l’Algérie dans l’évolution d’un monde extérieur qui a toujours fait partie de l’univers musulman ? Est-il encore utile de rappeler que l’islam est la seule religion monothéiste qui ait accordé le statut de , protégés, aux autres croyants ? D’ailleurs la reconnaissance explicite de la validité des messages prophétiques antérieurs confère à la tradition islamique une portée universelle qui devrait faire barrage aux antagonismes qui traversent aujourd’hui le rapport aux autres. De plus, l’islam assure également une fonction revivificatrice des traditions s’inscrivant dans l’héritage abrahamique.
Mahmoud Darwich (2007) se définissait dans un entretien avec le quotidien Il Manifesto comme le poète des vaincus, un « poète troyen », l’un de ceux « à qui on a enlevé jusqu’au droit de transmettre leur défaite ». Mais cette incapacité se construit. Voici comment ce processus opère en Algérie.
Encore lors de cette rentrée, l’Université algérienne considère les étudiants comme des poussières d’argile, des chiffres dont le nombre est en plein essor. En termes d’effectifs scolaires, l’explosion a été constante depuis l’indépendance (1962). Il s’agit, de manière parfois dramatique, de la « démocratisation de l’enseignement ».
Si les taux de scolarisation ont fortement crû, les objectifs de l’enseignement en Algérie n’ont jamais été pédagogiques. Aussi se sont-ils trouvés résumés par la gestion de flux démographiques toujours pensées en termes économiques et financiers, là où une formule générale tenait lieu de programme : le « développement national économique, social et culturel ». Dans ce contexte, on a observé un développement étonnant des infrastructures. En 1963, on comptait une ville universitaire ; aujourd’hui, il existe cinquante-huit centres universitaires à travers le territoire national.
Les algériens sont donc scolarisés et alphabétisés en nombre. Les conditions dans lesquelles se transmettent les savoirs créent pour autant une réelle difficulté pour être universitaire en Algérie et se considérer comme tel. Le plus souvent les enseignants s’appréhendent comme « enseignants du supérieur », et ce, en ce qui concerne en particulier les sciences humaines et sociales. Un grand nombre de ces enseignants a émigré vers d’autres cieux ou changé de secteur d’activité. Selon le quotidien El Watan du 21 avril 2004, 80 000 diplômés de l’enseignement supérieur ont quitté l’Algérie depuis la fin des années 70. Il existe aujourd’hui, selon les données fournies par le Ministère de l’enseignement supérieur, seulement 3 442 professeurs et maîtres de conférences parmi les 23 205 enseignants du supérieur.
Cette situation est le fruit d’une redéfinition des compétences de l’institution universitaire qui à sa création, durant la période coloniale, devait produire une élite capable d’encadrer les populations autochtones et de leur servir d’interface. Les enseignants algériens formés en français dans les restes de cette université coloniale, durant les années 60, se sont trouvés idéologiquement disqualifiés comme « intellectuels » dans la nouvelle société que le pouvoir politique appelait de ses vœux. Leurs collègues arabisants se sont vus, eux, disqualifiés sur le terrain de la science, les filières scientifiques d’excellence étant enseignées en français. L’université a donc été le lieu d’enjeux et de conflits autour des valeurs de l’enseignement, entre normes légitimes et normes dominantes. S’effondrant sous le nombre, elle a cessé d’être un espace de mobilisation scientifique pour se trouver soumise à des objectifs idéologiques et politiques. L’université s’est peu à peu désinstitutionnalisée et a été envahie par les rapports et les problèmes de la société : recul de l’âge au mariage, chômage… Il n’est pas exagéré d’affirmer que certains établissements universitaires sont devenus moins des lieux d’enseignement que de vastes salles d’attente, des espaces d’accueil, sinon même de stockage.
Non à la démocratisation par l’enseignement !
La démocratisation de l’enseignement n’a pas davantage signifié la démocratisation par l’enseignement. La scolarisation massive et l’accroissement rapide du secteur de l’enseignement supérieur n’ont pas réduit les inégalités devant le savoir. Les étudiants qui réussissent dans les filières les plus recherchées, celles soumises au régime du numerus clausus et dans lesquelles l’enseignement est en français, sont issus de milieux relativement aisés. Leurs parents sont le plus souvent des cadres supérieurs et possèdent une formation de niveau supérieur. Ceux qui « échouent » dans les filières arabisées sont plus souvent issus de milieux démunis, leurs parents étant pour la plupart ouvriers ou sans emploi, avec une formation inexistante ou de faible niveau. Or l’environnement culturel dans lequel baigne l’enfant est corrélé avec ses performances scolaires. Le fait de posséder une chambre dans un pays où sévit une dure crise du logement, un bureau pour s’isoler et travailler dans le calme, le fait de disposer de livres, de revues, d’un dictionnaire, mais aussi le fait de parler français à la maison sont autant de facteurs favorisant le bon déroulement de la scolarité, les « bonnes » orientations.
On s’aperçoit que, comme partout ailleurs, plus le capital scolaire des parents est élevé, plus ils investissent dans le domaine culturel en mettant à la disposition de leurs enfants non seulement les manuels scolaires, mais également d’autres biens de consommation culturelle non moins importants, favorisant par exemple la lecture ou la fréquentation d’un club sportif ou culturel. Des établissements privés laïcs à but lucratif ont ouvert leurs portes. Depuis quelques années, des parents de milieu aisé (souvent de professions libérales ou enseignants d’université – tenant donc un discours sur leur pratique) ont créé des établissements privés bilingues, français-arabe, afin que leurs enfants puissent poursuivre leurs études supérieures à l’étranger ou dans les Écoles supérieures algériennes et suivre des formations, comme la médecine et la pharmacie, en régime de numerus clausus. Ces parents sont plus proches de l’institution universitaire, en termes de connaissance des cursus et des débouchés, que ne le sont les parents de milieu modeste. Les réponses qu’ils offrent à travers la scolarisation de leurs enfants constituent un diagnostic sur les chances de promotion sociale que l’université algérienne massivement arabisée peut apporter aux enfants de cette catégorie sociale.
Un certain nombre de caractéristiques propres aux diverses zones géographiques permettent d’expliquer en particulier le contraste entre zones urbaines et zones rurales. La zone rurale est moins équipée en infrastructures scolaires et culturelles (bibliothèques, librairies) et souffre particulièrement de l’absence de structures d’enseignement préscolaire, diminuant ainsi les chances des élèves de cette zone d’effectuer une scolarité normale. De même, les conditions de scolarisation des élèves ruraux sont différentes de celles des élèves en zone urbaine. Ils rencontrent en particulier des problèmes de transport, ce qui explique que nombre de filles dans ces zones ne soient pas même inscrites. Ils n’ont pas bénéficié d’un enseignement précoce comme ceux de la zone urbaine, mais ont été également touchés par le redoublement. Issus le plus souvent d’un milieu populaire, ils sont moins favorisés d’un point de vue documentaire, ont tendance à lire nettement moins et de surcroît effectuent des travaux divers pour aider financièrement leurs familles, pendant que les élèves urbains mieux nantis s’adonnent à des activités sportives ou culturelles et ont accès aux langues étrangères par leur milieu ou grâce aux différents centres culturels étrangers.
Au-delà des conditions d’accès, la problématique de la langue d’enseignement a aussi empêché tout débat sur les contenus de la formation. Le recours à la « langue nationale » devait régler les problèmes de formation et de pédagogie. Une opposition s’est organisée idéologiquement entre les tenants de l’arabisation et ceux qui, en réalité, pratiquaient la seule langue française. La question de la connaissance de langues étrangères pour un développement scientifique a été réduite à cet affrontement.
La réalité linguistique aujourd’hui est que l’arabisation, dans bien des cas, n’a pas été assimilée. Ce n’est pas seulement une question de terminologie mais de rôle alloué à cette langue, de processus de construction conceptuelle : « Malgré l’arabisation quasi-généralisée de l’enseignement des sciences sociales au Maghreb, l’organisation de l’enseignement et de la recherche de ces disciplines continue à reproduire le modèle français des années 1970 et n’a pas donné lieu à une amélioration de la maîtrise des langues » (Kaci 2003 : 55).
Il y a eu d’abord la sacralisation de la langue, qui a été dotée d’une force idéologique. Ce processus a fait éclater la langue arabe, car il a eu pour effet de fixer des vérités définitives et des positions acquises au lieu de mobiliser des ressources intellectuelles.
Nous pensons que le caractère unilatéral de la relation pédagogique et cette manière de se rapporter au savoir procèdent peut-être de la confusion, diffuse au sein du système éducatif et de la société, entre la science comme objet de « révélation », au sens presque religieux du terme, et la science comme processus de construction des concepts et des objets, c’est-à-dire des phénomènes.
Cette force immanente que l’on a attribuée à la langue explique en partie que, durant ces années, on ait observé une faiblesse dans les conditions didactiques et pédagogiques accordées à l’enseignement de l’arabe. Cette faiblesse est visible dans l’édition et la traduction en arabe. Il faut insister sur cette indigence en matière de traduction, à laquelle s’ajoute la faible maîtrise des langues étrangères : il n’existe aujourd’hui en Algérie que des restes de français, qui prennent la forme de quelques cours de terminologie en licence.
L’ensemble de ces éléments, unis au fait que les universités algériennes ne sont pas classées dans les grandes enquêtes sur l’enseignement supérieur comme celle réalisée par l’université de Shanghai, expliquent la faible valeur sociale des études en Algérie. Ceci, associé au désir d’aller ailleurs, de partir, qui traverse la jeunesse et plus en général la société algérienne, permet de comprendre pourquoi l’utilisation de la langue française marque les contours de ce qui pourrait être une élite algérienne. Ce qui peut choquer au première abord apparaît toutefois comme légitime dans un contexte plus général, où les jeunes entendent sans arrêt parler de mondialisation : ils veulent appartenir au monde et refusent l’idée de rester au bord du trottoir. Il y a à peine une année, le gouvernement a renoncé à envoyer les meilleurs bacheliers étudier à l’étranger. Mais si l’État vient d’interrompre ces envois, les enfants de la nomenklatura et de la maigre bourgeoisie intellectuelle continuent d’être envoyés à l’étranger par leurs parents, après avoir suivi un cursus scolaire soit dans ces écoles privées et bilingues que leurs parents ont créées sur le mode militant, soit dans le nouveau « Lycée International Alexandre Dumas » créé à Alger par les services culturels français.
Les frais de scolarisation de ce dernier sont importants, eu égard au pouvoir d’achat en Algérie, mais les parents trouvent dans cette filière la possibilité d’envoyer leurs enfants étudier en France sans rencontrer aucune difficulté pour obtenir le visa nécessaire. Il est important de souligner que, lorsqu’ils en ont les moyens, ces parents ne s’appuient plus sur l’école publique. Ces filières d’exfiltration des enfants permettent par ailleurs d’expliquer, du moins en partie, l’intérêt des parents aisés pour la scolarité de leurs enfants : ils mobilisent à cette fin un certain nombre de ressources matérielles et pédagogiques et cherchent ainsi à accroître les chances de réussite de leurs enfants, c’est-à-dire leurs chances de suivre une formation supérieure à l’étranger.
La formation est donc validée par l’extérieur, à travers les universités étrangères et surtout françaises, celles-ci s’inscrivant dans un système d’enseignement bien connu par les Algériens.
Aussi la promotion de l’excellence est-elle redevable d’une formation à l’étranger, ce qui illustre la marginalisation et la déperdition d’un potentiel scientifique et culturel précieux. Peu de ces jeunes rentrent en Algérie. Le pays s’interdit d’avoir une élite en mesure d’interpréter le réel depuis une identité algérienne.
L’ensemble des acteurs du système scolaire évoquent désormais cet excès de politisation dont souffre le système de formation et d’enseignement de la langue. Remettre en cause une telle situation devrait représenter un objectif central des réformes proposées mais toujours repoussées. Car le constat du faible rapport à la science renvoie toujours à l’abandon de la défense de la personnalité arabo-musulmane des Algériens. C’est ainsi que les politiques se posent, à chaque fois, en chevaliers du religieux.
Pourtant, précisément à cause de la langue, les inégalités n’ont pas été résorbées. Les couches moyennes et supérieures de la société continuent de former leurs enfants pour et par l’extérieur. Leur objectif ultime consiste à contourner l’université algérienne et à éviter les universités de masse. La spécificité du cas algérien vient du fait que l’accès à l’emploi et la promotion sociale ne passent pas par la langue arabe. C’est la connaissance des langues étrangères, du français et de l’anglais en particulier, qui rend possible une qualification validée à l’intérieur même du pays par l’encadrement au sein de sociétés privées qui prolifèrent dans le pays aux côtés des sociétés publiques. De même, la connaissance du français permet aux étudiants d’intégrer les nouvelles écoles supérieures : écoles des banques, des affaires, des assurances… Toutes les opportunités d’emploi leur sont réservées.
On peut donc dire que l’enseignement supérieur étranger ou à l’étranger est d’autant plus attractif en situation de faiblesse des échanges inter-universitaires, de rareté du livre scientifique et de bas niveau du fonctionnement des bibliothèques. La quête d’une formation supérieure à l’étranger correspond aussi au désir de s’intégrer et de fonctionner dans un contexte intellectuel de qualité.
Face à ces problèmes, la réflexion ne peut porter sur la seule architecture du système. Elle devrait faire une part plus importante à l’évaluation des contenus et aux conditions de leur transmission. L’arabisation, portée par des catégories sociales qui cherchaient à se repositionner au sein de la société et qui s’est depuis généralisée dans les universités, ne permet qu’une intégration très faible de ces dernières dans l’environnement social.
On perçoit bien la difficulté à maintenir sur place une élite intellectuelle algérienne capable de produire un projet de société. Dans la scolarisation de ses enfants, cette élite poursuit aujourd’hui une stratégie du « sauve qui peut ». L’analyse que nous avons esquissée pose le problème de la capacité des autorités algériennes de créer les conditions permettant de maintenir sur place une élite susceptible de conduire, en quelque langue que ce soit, une réflexion sur la société. La réponse ne saurait se réduire au « caractère sacré » de la langue arabe. Les manipulations qui affectent la langue arabe et l’islam trouvent leur source ailleurs : dans la gestion politique de ce pays. Le choix de réfléchir au rôle de l’université et de la langue dans la production des savoirs reviendrait à vouloir susciter une société fondée sur la production plutôt que sur la rente. Ce choix permettrait d’envisager le maintien sur place d’une élite dont l’existence suppose certes des conditions économiques, mais aussi des conditions politiques, parmi lesquelles l’exercice de la démocratie et l’accès aux droits humains. La faiblesse de l’environnement culturel et les rendements du système éducatif expliquent le poids des structures familiales dans la société algérienne. Les systèmes autoritaires n’en sont que plus confortés, car les individus demeurent englués dans cette catégorie au détriment de l’appropriation d’un rôle social dans la sphère publique.
L’arabisation au service d’un pouvoir autoritaire
Loin de produire un homme nouveau et libéré du regard infériorisant de l’Autre, la politique d’arabisation, réduite à un simple passage de langue au service d’un pouvoir autoritaire, a surtout produit un être aliéné, produit par un système de formation des élites qui puise sa légitimation dans le rapport à l’Autre plutôt que dans la science. Il faut rappeler que les élites qui avaient été formées en langue arabe, y compris les oulama ou le poète national Moufdi Zakarya, furent autant contraintes à l’exil que les élites francophones. Il faut évoquer la suppression des medersa et des lycées franco-musulmans qui assuraient de façon efficace un enseignement bilingue. Le passage de langue fut d’abord l’occasion de domestiquer la société à travers la réduction de la langue arabe à une catégorie du sacré. Ceci est vrai d’ailleurs pour d’autres pays, comme l’Égypte ou la Syrie, où une large partie des élites pouvant s’exprimer aussi bien en arabe qu’en français et en anglais se trouvent également à l’extérieur.
Au-delà des explications hâtives qui pontifient sur les modes de commandement autoritaire qui seraient propres aux sociétés arabes, il faut en référer à l’origine sociale des dirigeants algériens qui, peu scolarisés pour la majorité, semblent craindre le maintien ou l’émergence d’une élite, qu’elle soit arabophone ou francophone. Toutes les mesures prises sur le plan pédagogique, comme la suppression de l’enseignement de la philosophie intervenue à un moment donné ou la transformation en sens réducteur de l’enseignement de l’histoire, ont eu pour objectif d’enfermer les élèves dans une pensée circulaire, peu dialectique, sans mémoire ni esprit critique. Le dictionnaire du peuple a changé à cette occasion. Pour un régime autoritaire et dénué de toute légitimité fondée sur le savoir, la tentation de brider les capacités de cette langue était irrésistible. Ces dirigeants sont incapables d’organiser une reproduction et s’éloignent du message coranique sur la science en même temps qu’il s’en réclament. Rappelons comment Moussa, à l’occasion de sa rencontre dans la caverne avec un personnage doté de savoir, demandait à bénéficier de l’enseignement de ce dernier : « Puis-je te suivre afin que tu m’enseignes ce qui t’a été enseigné concernant la direction juste ? » (xviii, 66-68.)
Ainsi, d’une l’explosion des effectifs scolaires accompagnée de l’implosion des systèmes d’éducation, et d’autre part les liens de soumission entre les institutions et l’environnement social et culturel immédiat, ont donné naissance et entretenu une clôture dogmatique au service de pouvoirs autoritaires et fondés sur des manipulations du sacré. La science nous apparaît donc comme une valeur qui peine à se frayer un chemin dans cette société. Il faut certes la promouvoir, mais ses implications sociales et politiques – à commencer par l’émergence d’individus dotés d’un savoir sur leur réalité et aspirant à un mieux-être qu’ils sont désormais en mesure de penser – empêchent un pouvoir épuisé, gérant son seul maintien, de la développer. Les détenteurs actuels du pouvoir, bien qu’informés des dérives du système éducatif, continuent de tenir un discours quantitativiste qui bouche toute réflexion pédagogique axée sur l’absence d’une langue savante et d’instruments scientifiques. La dernière rentrée universitaire se déroule de façon chaotique et ce n’est plus une affaire de langue…
Le poète, lui, bien qu’acculé, est parti sur une note d’espoir :
Il ne me reste plus de trace à perdre :
Libre je suis tout près de ma liberté. Mon futur est dans ma main.
Bientôt je pénètrerai ma vie.
Je naîtrai libre, sans parents,
Et je choisirai pour mon nom des lettres d’azur… Mahmoud Darwich (2004) Par OUSSEDIK FATMA Professeur de Sociologie, Université d’Alger II-Chercheure associé
- CRB - PAC : Une place de dauphin en jeu pour le Chabab
- Mikhail Bogdanov reçu par Tebboune : L’Algérie et la Russie consolident leurs relations
- Après les viandes et les poissons : Y-a-t-il une spéculation sur les prix du café ?
- CSC - Le rêve grandissant des Sanafir en coupe : L’appétit vient en mangeant
- CSC - Le rêve grandissant des Sanafir en coupe : L’appétit vient en mangeant
- ESS : Prêts pour la JSS
- Suite à la riposte iranienne: La Malaisie appelle à une désescalade au Moyen-Orient
- Appel à participation au colloque sur les transformations du théâtre en Afrique à l’ère des médias
- Education nationale : Les orientations de Belabed pour le 3e trimestre
- Rumeurs sur une révision de l’allocation chômage: La Présidence dément
- USMA - Après sa brillante qualification pour les ¼ finale : Cap sur l’US Biskra
- ESS : L’Entente met le paquet pour Chetti et Draoui
Infos régionales

Autres sites
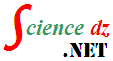
Le site des sciences en Algérie
Vous cherchez un emploi? Essayer la recherche d'emploi en Algérie
 Babalweb Annonces
Babalweb AnnoncesPetites annonces gratuites