Bouteflika
demande de pardon, entre devoir de mémoire et impunité

En lisant la lettre que l’ex-président Bouteflika a adressée au peuple algérien le 2 avril dernier, dans laquelle il a demandé pardon, j’ai eu un moment de vide intérieur. Je n’arrivais pas à percevoir, au-delà de l’éventuelle dernière fourberie qui sous-tendrait son message, le sens véritable à donner à cette missive.
Mais j’ai voulu aller au-delà de cette première approche politique en me demandant si réellement on avait affaire à une sincère repentance d’un homme malade, au crépuscule de sa vie qui, à son firmament, n’avait offert que mépris sur mépris à ce peuple ?
Puis je (alors que, disons-le tout de go, je ne mets jamais le «je» dans mes contributions politiques) me suis senti interpellé en tant que personne, à considérer donc que l’approche humaine prenne le dessus sur l’approche politique initiale.
Si Bouteflika était sincère dans sa demande de pardon, moi qui suis un survivant de l’islamisme politique, suis-je prêt, suis-je en état, «in the mood», à lui accorder cette part de pardon qu’il demande, cette petite parcelle qui relève de l’autorité de mes tréfonds et de mon moi subjectif ? Dans cette introspection, je me suis rappelé deux éléments constitutifs, parmi tant d’autres, qui forment le socle du combat politique du militant démocrate que je suis depuis ces trois dernières décades : le devoir de mémoire et le devoir de justice, donc la lutte contre l’impunité.
Le premier concerne le principe du pardon, ce qui forme son intrinsèque essence. Le «citoyen» Bouteflika me fait donc une demande que le président Bouteflika m’avait déniée depuis 1999 et durant toutes les dures années de son pénible règne. En se lançant dans son inique projet de «concorde civile», en septembre 1999, le Président a décidé de pardonner à ma place, sans demander mon avis et sans demander l’avis de toutes ces Algériennes et de tous ces Algériens qui ont subi dans leurs corps et leurs âmes les affres du terrorisme islamiste, à un moment où les terroristes islamistes n’étaient même pas dans cette logique du pardon.
Pire, avec son infamante «Charte nationale», en 2005, le président Bouteflika nous a interdit, sous peine de poursuites pénales, d’identifier le socle idéologique et les références intégristes des terroristes des GIA, AIS, FIDA, AQMI et tous les sanglants sigles de la honte que portaient comme effigies ces hordes de barbares qui ont fait le serment d’éteindre toutes les lumières qui scintillent dans ce pays.
Depuis cette charte, les Chebouti, Meliani, Zouabri, Gouasmi et tous les autres visages de la haine ne sont plus que des «victimes de la tragédie nationale», tout comme Tahar Djaout, Boucebci, Belkhenchir, Boukhobza, Mekbel, Yefsah et la liste est longue des noms de nos ami(e) tombé(e)s sous les balles assassines et les sabres de ceux-là qui «prennent le sabre comme emblème et condamnent au lieu d’absoudre» (in les Vigiles de Tahar Djaout).
Avec ces deux textes fondateurs de l’amnésie, le président Bouteflika a interdit à l’Algérie de solder les affres de ces sanglantes années et lui a dénié le droit d’exiger de l’Etat – cet Etat que nous voulons séculaire – qu’il défende son droit inaliénable à la protection de la mémoire de toutes celles et de tous ceux qui sont morts pour que l’Algérie soit libre, démocratique, égalitaire, laïque et respectueuse de toutes ses diversités : politiques, culturelles, identitaires et linguistiques.
En décidant de violer nos mémoires, à ce jour meurtries, et de décréter de facto une amnésie des âmes, après avoir accordé une amnistie générale de jure, le président Bouteflika a remis sur selle des milliers de terroristes islamistes et a mis un bâillon, long de toutes ses infinies années de vengeance qu’il ruminait en lui, sur la bouche de toutes celles et de tous ceux qui revendiquent leur droit à la mémoire. Leur droit de ne pas oublier et de ne pas panser dans l’amnésie leurs plaies et celles de leurs ami(e)s et de ne pas pardonner à ces terroristes islamistes qui, eux, n’ont jamais demandé pardon.
Pire, ils continuent de nous narguer du haut de leur amnistie bouteflikienne synonyme d’impunité. Comment puis-je donc accorder mon pardon au «citoyen» Bouteflika alors que je sais qu’il n’a que mépris et pour le pardon comme sens moral et pour le citoyen que je suis dans son acception politique, vu que dans sa culture politique, il n’y a point de place pour la citoyenneté ? Ceci me ramène donc à cette notion d’impunité. Par définition, il n’y a impunité que parce qu’il y a déni de justice. Ces deux notions – justice et impunité – s’opposent car l’une est la négation de l’autre. Et c’est donc le second élément constitutif auquel je faisais référence préalablement.
En pensant à l’impunité, je ne puis ne pas penser à cette «pensée» publiée par Mme F. Belkhenchir, l’épouse du professeur de pédiatrie Djilali Belkhenchir, assassiné à l’hôpital de Birtraria, à El Biar, un certain 10 octobre 1993. Dans son petit encadré, publié par El Watan dans son édition du 10 octobre 2008, Mme F. Belkhenchir disait ceci : «Le professeur de pédiatrie Djillali Belkhenchir, 52 ans, mort trop tôt, mort pour rien, assassiné par les siens.» (sic) Cette pensée m’obsède depuis dix ans et six mois.
Je l’ai découpée et je la porte dans ma poche durant toutes ces années. Elle a jauni depuis, mais elle me sert de repère. De piqûre de rappel aussi. Elle me permet de continuer à militer afin que la mort des nôtres, de tous nos amis, ne soit pas vaine. Afin que toutes ces femmes et tous ces hommes, membres de la famille qui avance, ne soient pas «morts trop tôt, morts pour rien», pour paraphraser Mme F. Belkhenchir et ses enfants.
En repensant donc à ce cri du cœur de Mme Belkhenchir, qui est tout aussi celui de Mme Djaout, de Mme Raja Alloula et de toutes les veuves qui portent, encore vivaces, les plaies de ces années de sang et de cendres, je prends conscience que Birtraria, c’est à une centaine de mètres, à vol d’oiseau, du ministère de la Justice. Un ministère qui a couvert de son imprimatur, sur décision du roitelet du moment, les, crimes de sang de ces barbares islamistes et qui a préparé le lit de jure de l’impunité, en formalisant le corpus juridique du déni de justice imposé à toutes les victimes et de l’islamisme politique triomphateur et de l’arbitraire de l’Etat.
C’est donc à l’aune du cri de Mme Belkhenchir, tout en fixant du regard le portrait qui accompagnait sa pensée et celle de ses enfants, offrant un visage du défunt Djillali au regard profond et qui porte au loin, publié un certain 10 octobre 2008, l’année du viol de la Constitution par le président Bouteflika, pour devenir le roitelet d’un pays meurtri qui ne peut même pas juger les assassins de ses propres enfants, pour leur offrir une justice, que je perçois le côté pathétique et fourbe de cette demande de pardon.
A la limite, elle est superfétatoire, vu que le mal qu’il a fait est d’une infinie profondeur. In fine, personnellement, si je dois accorder mon pardon, c’est plutôt à tous nos amis qui ont renoncé à notre combat, par usure, par fatigue, par dépit, par renoncement, par peur aussi, alors que nous n’avions jamais cessé de promettre à nos amis assassinés, en arpentant tous les cimetières que compte ce pays torturé, que leur sacrifice ne sera pas vain.
En marchant aujourd’hui, pour le 7e vendredi de suite de cette joyeuse protesta citoyenne, je repense donc simultanément, figé dans mon mouvement par cette foule compacte qui n’arrive pas à avancer tellement les rues d’Alger semblent exiguës, à cette demande de pardon du «citoyen» Bouteflika et au cri de Mme Belkhenchir.
Je mettais les deux en perspective, au prorata des événements de ces deux derniers mois. J’ose espérer qu’en voyant ces millions de femmes et d’hommes battre le pavé pour demander une Algérie libre et démocratique, Mme Belkhenchir nous pardonnera d’avoir attendu tant d’années, une éternité de supplices, pour lui prouver que Djillali Belkhenchir n’est pas «mort pour rien».
Que la mort de Tahar Djaout et de tous les autres a un sens. Un profond sens et une immense portée politique, historique et humaine. Son pardon à elle m’importe tellement.
C’est l’essentiel pour moi, car il me réconcilie avec cette famille qui avance. Une famille qui a repris sa marche vers l’avant, dans toute la splendeur de sa générosité et de son intelligence humaines, après de longs détours et d’infinis silences coupables, grâce notamment à toute cette jeunesse, génération facebook par excellence, qui n’a même pas connu la décennie sanglante. Une marche, cette fois, qui se fera indubitablement sans… marche arrière.
J’ai la naïveté de le croire, la volonté et la ferme résolution de ne rien céder à ceux-là qui ont grugé nos espérances. C’est ma façon à moi d’exorciser et les années Bouteflika et les démons de l’islamisme politico-terroriste et de l’arbitraire d’Etat.
Par Salah Hannoun , Avocat et défenseur des droits humains
- CRB - PAC : Une place de dauphin en jeu pour le Chabab
- Mikhail Bogdanov reçu par Tebboune : L’Algérie et la Russie consolident leurs relations
- Après les viandes et les poissons : Y-a-t-il une spéculation sur les prix du café ?
- CSC - Le rêve grandissant des Sanafir en coupe : L’appétit vient en mangeant
- CSC - Le rêve grandissant des Sanafir en coupe : L’appétit vient en mangeant
- ESS : Prêts pour la JSS
- Suite à la riposte iranienne: La Malaisie appelle à une désescalade au Moyen-Orient
- Appel à participation au colloque sur les transformations du théâtre en Afrique à l’ère des médias
- Education nationale : Les orientations de Belabed pour le 3e trimestre
- Rumeurs sur une révision de l’allocation chômage: La Présidence dément
- USMA - Après sa brillante qualification pour les ¼ finale : Cap sur l’US Biskra
- ESS : L’Entente met le paquet pour Chetti et Draoui
Infos régionales

Autres sites
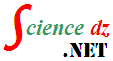
Le site des sciences en Algérie
Vous cherchez un emploi? Essayer la recherche d'emploi en Algérie
 Babalweb Annonces
Babalweb AnnoncesPetites annonces gratuites