Entre fiction et réalité
Sur les traces de John Le Carré

Tout commence au Nord du Kenya avec l’assassinat de Tessa, épouse de Justin Quayle, diplomate britannique en poste à Nairobi. Celui-ci ne tarde pas à établir un lien entre le crime et l’enquête que menait sa femme sur les agissements d’une société pharmaceutique en Afrique.
Pour connaître la vérité – mais aussi maintenir sa compagne vivante en sa conscience – Justin prend le relais d’une investigation qui le mènera à travers le monde, y compris à l’île d’Elbe, lieu de naissance de Tessa (peut-être un clin d’œil de l’écrivain au destin de l’Europe puisque Napoléon y fut déporté ?).
C’est l’entrée en matière de The constant gardener (La constance du jardinier) paru en 2001 chez Hodder & Stoughton sous la plume de John Le Carré qui demeure, du haut de ses 88 ans et de ses 25 romans, le maître toujours alerte de la littérature d’espionnage.
Qui ne l’a pas lu a sans doute vu l’une de la quinzaine d’adaptations à l’écran de ses œuvres : L’espion qui venait du froid (20 millions d’exemplaires du livre), La taupe ; La Maison Russie ; Le directeur de la nuit ; Le tailleur de Panama ; Un homme très recherché, etc. Avantage indéniable pour un auteur du genre, Le Carré a été lui-même un homme de l’ombre.
En effet, après ses études de langue et littérature (anglais, français, allemand) à Berne puis Oxford et une brève carrière au Foreign Office, il est recruté dans les années 50’ à Hambourg par l’Intelligence Service.
Tout en se livrant à ses activités secrètes, il commence à écrire sous le pseudonyme qu’il a conservé à ce jour, étant David Cornwell pour l’état civil. Dans les années 60’, «balancé» avec plusieurs de ses honorables collègues par Kim Philby, taupe du KGB au MI5, il arrête sa carrière d’espion et se consacre à l’écriture.
Son expérience a certainement contribué à son succès, mais son talent littéraire est largement reconnu. Romancier majeur de l’underground de la Guerre froide, la chute du Mur de Berlin en 1989 l’amène à explorer de nouveaux sujets. Avec La constance du jardinier, il s’intéresse au monde de l’industrie pharmaceutique, se rendant compte qu’il est peut-être aussi implacable et secret que celui-ci qu’il a quitté.
«Je voulais faire quelque chose contre cette forme aiguë de néocolonialisme qu’est l’exploitation financière de l’Afrique. J’avais d’abord pensé à l’industrie du tabac, puis à celle du pétrole. Mais un ami, grand connaisseur de l’Afrique, m’a convaincu qu’il n’y avait rien de pire que l’industrie pharmaceutique…», déclare-t-il en 2001 dans une interview à Swissinfo, ajoutant : «80% des malades du sida vivent en Afrique subsaharienne. Mais ils ne représentent que 1% du marché des médicaments antisida.
Si les médicaments performants étaient commercialisés pour 320 dollars par an et par patient, au lieu des 10 000 à 15 000 dollars actuels, les labos feraient encore du bénéfice.» Pour construire sa fiction, John Le Carré a mené une véritable enquête internationale, allant sur le terrain, rencontrant des informateurs secrets, bref, utilisant toutes les ressources de son ancien métier, si ce mot peut convenir à l’activité d’agent secret. Défrichant le jardin de la réalité, il va y planter sa trame, ses intrigues et ses personnages.
Mais le jardinier du roman, Justin Quayle, pétri des meilleures valeurs britanniques et passionné de botanique, ne reculera devant rien pour élucider le meurtre de sa femme et remonter la filière à partir d’un médicament contre la tuberculose testé en Afrique par la multinationale KVH basée à Bâle. Le veuf téméraire réalisera vite qu’il a affaire à de puissants intérêts aux moyens colossaux d’influence, de corruption et de dissuasion.
Contre l’adversité, ce fleuriste de la vérité opposera la bêche de la constance, poursuivant à ses risques et périls le dévoilement des «pharma-milliardaires» et leurs réseaux de politiciens corrompus, de diplomates intéressés, d’ONG téléguidées, de chercheurs véreux, de revues médicales sponsorisées, etc. John Le Carré déclarera : «A mesure que je me suis aventuré dans la jungle pharmaceutique, j’ai réalisé qu’à côté de la réalité, mon histoire ressemblait à une aimable carte postale.» Au-delà du «complotisme», virus dont la propagation est antérieure à celle du coronavirus, l’écrivain souligne ainsi combien la réalité peut dépasser la fiction, a fortiori dans un monde déboussolé. Son roman prend aujourd’hui une dimension nouvelle par la pertinence de ses points de vue et son invitation à réfléchir et à réagir.
En ces moments où l’humanité affronte une pandémie fulgurante et inédite, les regards sont braqués sur le front où s’illustrent notamment les hommes et les femmes en blanc du monde entier. L’attention se concentre aussi sur les gouvernements et leurs décisions, les oppositions et leurs déclarations et, via les réseaux virtuels, les citoyens et leurs réactions. De cette effervescence sans pareille, dure et parfois outrancière, se dégage l’impression angoissante d’une cacophonie mondiale, y compris dans des régions comme l’Europe qui disposent d’un cadre institutionnel commun.
En relisant John Le Carré, on peut imaginer assez aisément la fébrilité qui doit régner dans les états-majors des multinationales pharmaceutiques, lesquelles se tiennent comme de coutume derrière les rideaux, sinon en coulisses de l’agitation planétaire. Quelques déclarations ça et là, quelques actions de bienfaisance, une prudence de mise dans une communication se voulant humaniste, brodée à la virgule près, tandis que couvent des intérêts faramineux, aussi exponentiels que le virus.
Entre 1999 et 2017, les onze plus grands laboratoires du monde ont brassé 1019 milliards d’euros de bénéfices dont 925 milliards, soit 90,7%, ont été distribués à leurs actionnaires. Là dedans, l’industrie du vaccin, relativement modeste (3% du chiffre d’affaires global en 2009), se présente, avec la montée en puissance des biotechnologies, comme le créneau le plus dynamique (croissance de 24% entre 2011 et 2014). Cette branche de l’industrie pharmaceutique est dominée par quatre groupes (Merck, Sanofi, GSK et Pfizer) totalisant 65% du chiffre d’affaires. Des groupes de pays émergents s’affirment sur les parts de marché restantes : Serum institute et Biological E (Inde), Institut Butatan et Bio-Manguinos (Brésil), CNBG (Chine)… Aujourd’hui, les spécialistes semblent unanimes pour affirmer que l’enjeu principal est la mise au point d’un vaccin contre le Covid-19.
De fait, on constate une énorme mobilisation des groupes pharmaceutiques, laboratoires, universités et centres de recherche divers, engagés dans une course effrénée déjà qualifiée de «guerre du vaccin». Le développement d’un vaccin exige de gros et longs investissements que les grands groupes sollicitent des Etats qui participent ainsi à cette compétition. Ce n’est pas un hasard si Paul Hudson, le patron du groupe français Sanofi, spécialiste du vaccin, a appelé l’Union européenne à créer une agence spécialisée, à l’image de celle des Etats-Unis. Les bons capitalistes savent défendre l’étatisme quand leurs intérêts sont en jeu.
D’où, aussi, cet aveu du député socio-démocrate allemand, Karl Laubertach : «Le capitalisme a ses limites. Nous ne pouvons continuer à être dépendants de la Chine et des Etats-Unis pour notre médecine.» D’où encore l’exhortation du SG de l’ONU, Antonio Guteress, insistant sur un «accès juste et équitable» au futur vaccin, comme s’il ne croyait pas à la résolution onusienne proposée par le Mexique et adoptée par 193 Etats, dont les USA qui viennent de retirer leur soutien financier à l’OMS ! On compte à présent quelque 70 recherches du vaccin en ordre dispersé, prouvant que la mondialisation n’est pas encore devenue humanitaire. Même en des circonstances vitales pour l’espèce humaine, on ne peut faire exception au règne du profit et de la puissance.
Peut-on pourtant mettre en péril l’humanité et laisser couler l’économie mondiale pour préserver un seul de ses secteurs ? Comment ne peut-on pas envisager une agence mondiale de recherche où toutes les compétences de la planète travailleraient en commun ? Ces questions qui apparaissent en filigrane dans The constant Gardener, John Le Carré les exprimaient dans l’interview précitée : «Nous ne pouvons pas considérer les brevets sur les médicaments de la même manière que les brevets concernant, par exemple, un banal enregistreur. Il nous faut trouver un autre moyen de dédommager ceux qui inventent de nouveaux médicaments. Avec la réglementation actuelle, c’est un droit de vie et de mort que l’on exerce sur les personnes malades. C’est une forme de génocide.
Ça ne peut pas continuer ainsi.» Hélas, tout porte à croire pour l’instant que cela continuera ainsi dans un triomphe inexorable du lucre et de la bêtise. Recevant en janvier le prix Olof Palme pour l’ensemble de son œuvre, John Le Carré, qui s’est opposé à l’occupation de l’Irak comme au Brexit, a remis sa récompense financière de 100 000 dollars à Médecins sans frontières.
Il a surtout annoncé qu’il cesserait de publier. Mais ses romans, au cœur de l’histoire humaine contemporaine, porteront toujours la lucidité généreuse et inquiète qu’il voulait nous confier.
Par Ameziane Ferhani
- La déclaration de devises étrangères à l'entrée et à la sortie du territoire national
- Inauguration d'une usine de pièces automobiles et d'une unité de production de batteries
- CRB - PAC : Une place de dauphin en jeu pour le Chabab
- Mikhail Bogdanov reçu par Tebboune : L’Algérie et la Russie consolident leurs relations
- Après les viandes et les poissons : Y-a-t-il une spéculation sur les prix du café ?
- CSC - Le rêve grandissant des Sanafir en coupe : L’appétit vient en mangeant
- CSC - Le rêve grandissant des Sanafir en coupe : L’appétit vient en mangeant
- ESS : Prêts pour la JSS
- Suite à la riposte iranienne: La Malaisie appelle à une désescalade au Moyen-Orient
- Appel à participation au colloque sur les transformations du théâtre en Afrique à l’ère des médias
- Education nationale : Les orientations de Belabed pour le 3e trimestre
- Rumeurs sur une révision de l’allocation chômage: La Présidence dément
Infos régionales

Annuaire des sites algériens
Autres sites
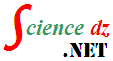
Le site des sciences en Algérie
Vous cherchez un emploi? Essayer la recherche d'emploi en Algérie
 Babalweb Annonces
Babalweb AnnoncesPetites annonces gratuites
