Lettre à ma sœur et Avant de franchir la ligne d’horizon de Habiba Djahnine
Des docs dédiés à des «histoires à ne pas dire»

Alors, un conseil : à vos tablettes ou à vos ordinateurs pour les voir. Nous en avons visionné deux qui la classent parmi les cinéastes qui ont l’audace de soutenir des «Histoires à ne pas dire», pour reprendre le titre d’un controversé documentaire sorti en 2007.
Habiba Djahnine, par contre, se situe à un tout autre niveau dans son rappel de la dévitalisation du pays, à un moment de défaite et d’humiliation dans l’histoire récente du pays, celle de l’après-Octobre 1988 à 2010.
Elle y fait montre d’honnêteté et de lucidité sur un sujet où pourtant la subjectivité, la sienne comme celle de ses interlocuteurs, est sérieusement démangée. D’ailleurs, ne faisant pas mystère sur son implication personnelle, elle débute ses longs métrages par un prologue en voix off où elle verbalise dans un style poétique ses intentions.
Par ailleurs, ses films, bien qu’ils ne s’y frottent pas peu, refusent d’être frontalement politiques. Ils s’écartent d’un militantisme carré au profit de la nuance et la sensibilité. Les silences, les hésitations, les regards et les larmes qui perlent chez ses interviewés les émaillent, traduisant leurs intériorités traumatisées tant les haltes mémorielles auxquelles ils sont invités sont pénibles. Aujourd’hui, dans l’après-hirak, ces films ont valeur de précieux documents. Ils ont beaucoup à nous dire.
Dans Lettre à ma sœur, 1h10mn de durée, Habiba Djahnine remue des souvenirs encore vivaces en suivant les traces de Nabila, sa sœur, dix ans après son assassinat, un 15 février 1995, par un groupe armé de fusils de chasse à canon scié, un type d’arme qui ne laisse aucune chance à sa cible recevant une décharge tirée obligatoirement à bout portant. Le tort de Nabila est d’avoir été une combative présidente de l’association féminine «Tighri Ntmettouth» (Cri de la femme).
D’avoir été, lycéenne, déjà militante en tant que dirigeante de la coordination des lycéens de Béjaïa. Etudiante à Tizi Ouzou, elle participe à la fondation d’un syndicat étudiant.
D’avoir été également du combat identitaire, au MCB. Puis, devenue architecte, elle est militante active du PST dont elle est de sa direction en 1991. Enfin, en 1992, elle se déleste de ses attaches politiques pour se consacrer à la mère de toutes les batailles, celle de la cause féminine, la quintessence de toutes les inégalités.
A la fleur de l’âge, 29 ans, au moment de son trépas, Nabila contrarie l’intégrisme d’autant qu’elle met au cœur de son engagement la mobilisation de la «plèbe» des femmes au fin fond des montagnes, livrées pieds et poings liés à la féodalité et aux rigueurs patriarcales du code de la famille. Comme à Ahriq Bouzegane, où, à sa mémoire, à l’arrivée de la réalisatrice, des villageoises entonnent a capella un remuant chant sur un air traditionnel du patrimoine maghrébin.
Lettre à ma sœur, que son auteure n’a pu accoucher qu’au bout de dix années et dont la réalisation lui en a pris cinq, est aussi un hommage à toutes les femmes qui poursuivent le combat et dont quelques-unes sont interviewées. Leurs paroles valent d’être entendues.
Comme celle de la successeuse de Nabila à la tête de Tighri Ntmettouth qui, après le meurtre de celle qui a été son mentor, est demeurée tétanisée trois années, ne risquant pas un pas au dehors. Dans Avant de franchir la ligne d’horizon, 1h 8mn, sorti en 2011, elle ne change pas d’approche. Les plans fixes, les travelings et les panoramiques promènent mélancoliquement leur regard, fixant les lieux et les espaces.
Le film, un point d’étape sur 20 ans de mobilisation/répression politique depuis Octobre 1988, met à égalité ce qui est dit par les paroles de femmes et d’hommes qui en ont été les acteurs et ce que la caméra débusque.
Un état des lieux est dressé sans manichéisme, parfois presque de façon anodine, comme dans ce village où l’on voit des enfants jouer. Sauf qu’à y bien voir, filmés de loin, les filles et garçons, quoique voisins et parents, ne se mélangent pas. Les garçons s’amusent bruyamment à un «jeu de garçons» (le foot). Les filles se divertissent sagement dans un «jeu de filles» (la marelle). Le réquisitoire est là, «tranquille». Et si le bilan est épouvantable, il n’est jamais qualifié de désespérant par les interviewés.
Sans forfanterie, leur leitmotiv est : «Il faut cesser de se lamenter et plutôt agir». Les images d’époque sur le vacarme dans les rues et la fureur d’en découdre avec l’intégrisme et le pouvoir réunis sont en écho à leur témoignage : «Les jeunes en révolte croyaient avec la violence déstabiliser le pouvoir. Ils hurlaient : ‘‘Vous ne pouvez pas nous tuer, nous sommes déjà morts !’’ Pour notre part, nous n’étions pas à armes égales face au pouvoir et aux intégristes.
Nous, c’est le débat, eux c’est le langage des armes», constate amèrement un acteur de l’époque. Le tour de quelques-unes des quatorze associations nationales féminines nées dans l’après-Octobre 1988 est fait à Alger, Oran et en Kabylie.
Elles ont surtout été actives contre les violences faites aux femmes, violences dans le couple, violences sociales ou institutionnalisées au nom d’une inégalité assumée sans scrupule. Même dans le camp naturel de ces associations, comme le souligne la présidente de l’Amesnaw et militante au long cours dans le combat pour les libertés.
Elle a subi au début des pressions avec des insultes au téléphone, l’accusant de ternir la réputation de la Kabylie en mettant en avant la question des violences faites aux femmes : «Nous en Kabylie, on ne maltraite pas nos femmes, me rétorquaient-on. Même certains qui se disent des intellectuels me houspillaient».
Ils voulaient qu’elle milite «utile», par exemple pour tamazight, les droits de l’homme mais sur tous les plans plutôt que sur la seule question des violences faites aux femmes.
Elle rappelle, écœurée, qu’elle n’est pas une extraterrestre, qu’elle connaît la situation intimement. Comment peut-on la contredire alors que, rappelle-telle, le droit coutumier en Kabylie prive totalement la femme du droit à l’héritage ! Mais, note-elle, introduisant une lueur d’espoir en se projetant sur des luttes à venir : «Nous sommes en 2010.
Chacun a eu sa ‘‘guerre’’ dans ce pays. Eux ont fait la leur, 1963, 1974. Nous avons fait la notre. Mais, on n’est pas encore arrivés à capitaliser l’expérience par rapport à la révolte de 2001. Il ne faut pas arriver à une révolte pire que celle de 2001 en pertes humaines.» Même constat d’un universitaire de Constantine, ancien dirigeant du CNES originel, dont l’intervention clôture le film : «On n’a pas besoin de prendre du recul pour comprendre ce qui s’est passé.
Une sorte de désespérance a été installée au point que vous n’avez aucune légitimité si vous évoquez le potentiel de choses positives en notre pays. Vous n’êtes écouté que dans la critique nihiliste parce qu’on a abîmé les gens de l’intérieur. Changer le monde est une utopie indispensable. Car si on n’a pas cette projection, on est mal.
Et quand on l’est, on fait mal aux autres. On a besoin de cette utopie qui reste une utopie concrète. On a abîmé le pays, mais on ne l’a pas encore perdu.» Onze années après, le 22 février 2019, le hirak est venu combler ce vœu d’utopie.
- CRB - PAC : Une place de dauphin en jeu pour le Chabab
- Mikhail Bogdanov reçu par Tebboune : L’Algérie et la Russie consolident leurs relations
- Après les viandes et les poissons : Y-a-t-il une spéculation sur les prix du café ?
- CSC - Le rêve grandissant des Sanafir en coupe : L’appétit vient en mangeant
- CSC - Le rêve grandissant des Sanafir en coupe : L’appétit vient en mangeant
- ESS : Prêts pour la JSS
- Suite à la riposte iranienne: La Malaisie appelle à une désescalade au Moyen-Orient
- Appel à participation au colloque sur les transformations du théâtre en Afrique à l’ère des médias
- Education nationale : Les orientations de Belabed pour le 3e trimestre
- Rumeurs sur une révision de l’allocation chômage: La Présidence dément
- USMA - Après sa brillante qualification pour les ¼ finale : Cap sur l’US Biskra
- ESS : L’Entente met le paquet pour Chetti et Draoui
Infos régionales

Annuaire des sites algériens
Autres sites
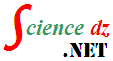
Le site des sciences en Algérie
Vous cherchez un emploi? Essayer la recherche d'emploi en Algérie
 Babalweb Annonces
Babalweb AnnoncesPetites annonces gratuites
