Mouloud Mammeri, héritage et transmission

Mouloud Mammeri était un romancier, un dramaturge, une âme de poète, un professeur de littérature française, un anthropologue et un linguiste. C’est un homme aux multiples facettes, un esprit a priori parfaitement inclassable ; mais Mouloud Mammeri c’était une cohérence, celle d’un intellectuel issu des dominés qui se donna in fine comme mission principale la défense et l’illustration de la langue et de la culture amazighes par ce qu’il n’avait pas le choix, que c’était pour lui l’appel de l’histoire. Il est décédé brutalement dans un accident de voiture près de Aïn Defla, dans la nuit du 25 au 26 février 1989, il y a donc 32 ans, alors qu’il revenait d’un colloque à Oujda (Maroc) sur l’amazighité.
Mammeri est né le 28 décembre 1917 dans une Algérie soumise à la domination coloniale, dans le village de Taourirt-Mimoun dans la commune actuelle de Beni Yenni (At Yenni) en Kabylie.
La télévision algérienne avait annoncé laconiquement sa mort. C’était la deuxième fois, faisait remarquer alors l’écrivain et journaliste Tahar Djaout(mort à son tour le 2 juin 1993 à Alger à la suite d’un abject attentat terroriste islamiste), que la télévision d’Etat d’alors parlait de Mouloud Mammeri : la première fois, c’était pour « l’insulter, lorsque, en 1980, une campagne honteusement diffamatoire a été orchestrée contre lui », en raison du déclenchement du premier printemps berbère, à la suite de l’annulation de sa conférence sur les poèmes kabyles anciens, à l’université de Tizi-Ouzou.
Mouloud Mammeri avait réussi alors symboliquement à redonner à la poésie, au verbe (awal) et à littérature, une place centrale dans la Cité, exactement comme les Imusnawen, amoureux du verbe des At Yenni, dont il est issu : la révolte de 1980, ne fut pas en effet directement déclenchée par la misère matérielle ou par d’autres raisons purement politiques, mais par l’annulation d’une conférence sur la poésie kabyle ! Et le peuple ne s’y trompe pas, car ce n’est certainement pas un hasard si Mouloud Mammeri reste une figure d’une popularité extraordinaire en Kabylie et au-delà chez les berbères du Maroc à titre d’exemple.
Si près de 200 000 personnes avaient assisté à ses obsèques, rendant la situation quasi-incontrôlable, ce n’est pas le fruit du hasard non plus. On peut en dire autant sur le fait qu’aucun personnage officiel n’a assisté à la cérémonie et que la foule compacte scandait des slogans contre le pouvoir en place.
Car Mouloud Mammeri était un éternel insoumis. Insoumis aux modes du moment et aux idéologies (passagères) de pouvoir, quoi que cela ait pu lui coûter. La défense et l’illustration de la langue et de la culture amazighes qu’il portait haut comme la dénonciation de la domination de manière générale, n’étaient de nature, ni à contenter la France coloniale avant 1962, ni à plaire aux nouveaux dirigeants de l’Algérie indépendante.
Mouloud Mammeri c’est avant tout un riche héritage, ponctué d’une exceptionnelle quête personnelle, puis un inlassable travail de transmission qui trouve ses ramifications auprès de nous aujourd’hui.
Il est à la fois un intellectuel profondément humaniste, caractérisé par une grande détermination mais dans le même temps, par une rare douceur, une curiosité sans faille et une grande ouverture d’esprit, contre vents et marées.
Un exemple indispensable dans la période que nous vivons, qui connaît d’inquiétantes radicalités.
Un riche héritage qui vient de loin
La sociologie de Pierre Bourdieu a été accusée de déterminisme car elle accorde une place prépondérante à l’héritage. Les contradicteurs du sociologue ne pensent pas que nos actes soient entièrement déterminés par notre héritage premier, celui de la naissance et de la filiation biologique ; celui en somme qui forme cet « habitus » qui est façonné par notre milieu d’origine, aussi fondamental soit-il. Nous répondons ici qu’il est nécessaire de voir l’héritage dans son aspect non-limitatif à la transmission qui émane du milieu familial, et que l’originalité de la pensée de Bourdieu (qui se liera par ailleurs d’amitié avec Mouloud Mammeri et qui accompagnera même la naissance de la revue Awal, créée par Mouloud Mammeri, avec Tassadit Yacine, en 1985), est de s’intéresser à notre héritage culturel, de mettre l’accent sur ce dernier (et non à l’héritage économique), pour comprendre le fonctionnement de nos sociétés.
Et l’héritage culturel est l’essentiel de ce qui caractérisa Mouloud Mammeri, même s’il est issu d’un milieu plutôt privilégié. Toute sa vie et son œuvre vont osciller entre une noblesse intellectuelle, qui lui donnera une indéniable solidité intérieure, et sa conscience à la fois de son amazighité, et de sa position de dominé, héritier d’une culture et d’une langue « persistantes », mais niées par les dominants et menacées donc de disparaître. Il se voit lui-même comme « le dernier maillon d’une chaîne qui pouvait lâcher ».
Mammeri nait dans une famille de « forgerons de la parole » (Iheddaden bbawal), au milieu des montagnes kabyles. Son père Dda Salem, était artisan bijoutier (Aheddad l fetta : litt. Forgeron de l’argent) mais aussi un « amusnaw » qui portait haut le mot, la parole (awal) kabyle et qui lui légua cet amour et cet art de la parole, une tradition qui vient de loin. Son éducation, son éveil au « fait berbère » se poursuivit également hors de la tribu paternelle des At Maamer. Il trouva la liberté, la détente et l’amour dans la tribu des At Menguellet, celle de sa mère.
Au Maroc, chez son oncle Dda Lounès, il découvrit les berbères autres que les kabyles, qui avaient gardé une plus grande authenticité, à cause d’une réalité, quoi que coloniale également, bien différente.
Mouloud Mammeri ira à l’école française dans son village puis partira donc à 11 ans (1928) vivre à Rabat avec son oncle Dda Salem, précepteur du Hassan II, fils du Roi Mohamed V. Dda Salem est un homme lettré en kabyle, en arabe (il fréquenta Médersa, connaissait en en sortant « 72 000 vers en arabe par cœur », mais récitait également les poètes Youssef Ou Kaci ou Cheikh Mohand Ou Lhocine en kabyle) et en français. A Rabat, il fréquente le lycée Gouraud (itinéraire privilégié par rapport à celui des indigènes, comme Féraoun, qui n’ont, en règle générale, pas accès à l’enseignement secondaire). Dans ce lycée, il découvre un milieu très différent de celui de son village, et il est le seul , avec un camarade marocain, issu du milieu indigène. Il découvre dans le même temps un monde parallèle, celui des berbères du Moyen-Atlas, grâce au commissionnaire de son oncle, berbère lui-même, qui lui permit d’avoir accès à des pratiques traditionnelles du groupe auquel il appartenait.
Durant les quatre années qu’il a passées à Rabat, il put profiter de l’enseignement français au lycée Gouraud (aujourd’hui lycée Hassan II), et découvrir dans le même temps le revers de la médaille : la réalité de la domination coloniale. « Le début de cette aventure fut pour lui un véritable traumatisme, une espèce de tempête absolument effroyable » écrit Jean Déjeux. Il reçoit le choc de la culture occidentale et découvre un monde qui lui est étranger : « rationalité », existence d’autres religions, d’autres cultures, etc. mais bannissement de ce qu’il était profondément, les berbères, imazighen, sauf peut-être en cours de latin en troisième où son professeur fit travailler la classe sur « La guerre de Jugurtha » de Salluste. Il fit alors l’admiration de l’enseignant, car en lieu et place des 15 lignes demandées par ce dernier, il en rendit cinquante. Le professeur finit par s’exclamer après réflexion quelques temps après cet épisode : « J’ai enfin compris pourquoi Mammeri écrivait trois fois plus pour « La guerre de Jugurtha », car Jugurtha est l’ancêtre des Maghrébins ! », confie Mammeri à plusieurs reprises.
Cette entrée brutale dans la vie, au sein de la réalité de la colonisation et auprès des autres, est une somme de destructions douloureuses qui s’opèrent dans ce en quoi le jeune Mammeri avait cru avec le plus de foi et de ferveur.
Mammeri retourne quatre ans plus tard en Algérie et étudie au lycée Bugeaud (actuellement lycée Abdelkader) à Alger, où il prépare son baccalauréat. « Au lycée, disait-il, on me faisait étudier l’Orient et la Grèce, l’Angleterre, sauf nous, car nous n’étions nulle part ; et si nous étions, c’était sous la bannière des autres ». Il eut ensuite comme professeur de philosophie Jean Grenier, le même que Camus. Il rédige son premier texte dans la revue Aguedal au Maroc, « La société berbère » qui a retenu l’attention de ce dernier et il s’y se distingue déjà par un effort de valorisation en même temps qu’un regard critique à l’endroit des siens : il a cette phrase notamment qui restera : « La société berbère persiste et ne résiste pas ».
De là, il part pour le lycée Louis-le-Grand à Paris avec en vue l’Ecole Normale Supérieure de la rue d’Ulm, puis il est mobilisé en 1939 ; puis à nouveau en 1942 après le débarquement américain à Alger. Il participe aux campagnes d’Italie, de France et d’Allemagne. Il rencontrera au sein de l’armée française d’alors des berbères, notamment du Maroc, des Chleuhs et des Rifains qui n’avaient toutefois pas conscience, comme lui, de leur amazighité. C’est à la fin de la guerre qu’il prépare à Paris, à la fin de ses études de lettres classiques à la Sorbonne, le concours de professorat de lettres avant de rentrer enseigner en Algérie et à écrire…jusqu’en 1957, date à laquelle il quitta l’Algérie clandestinement par le Maroc jusqu’en 1962, car il était recherché à Alger dans la cadre de sa collaboration avec le FLN.
Il emprunte ensuite le chemin de l’écriture, du théâtre, de l’anthropologie, de la linguistique, travaille inlassablement, depuis la sortie de son premier roman, au titre évocateur « La colline oubliée » en 1952 aux éditions Plon. Mouloud Mammeri ne cessa d’œuvrer pour rendre la parole aux siens, pour exhumer une langue et une culture qui auraient pu être moribondes, avec la conscience de l’appel de l’histoire : « Je n’avais pas le choix. L’histoire me pressait de plus en plus instamment » comme il l’écrit dans son introduction aux « Poèmes kabyles anciens », une œuvre majeure publiée en 1980. Il y fait ce constat notamment pour ce qui est de la poésie kabyle : « J’ai vu mourir les derniers vieillards à qui le sens de l’existence et sa valeur résidait encore dans les vers amoureusement conservés. », puis « La catégorie de poètes prestigieux, dont le rôle dans la Cité était souvent de premier plan, disparait […] grosso modo au lendemain de la révolte de 1871 », ce qui met clairement en accusation un système colonial qui a détruit les bases culturelles de la société amazighe. Dans cette introduction, où les poètes anciens apparaissent dans un impressionnant défilé : Hadj Mohand Ouachour, Mohamed larbi Ikaabichen, Ismaïl Azikiw, Cheikh Mohand-ou-Elhocine, Si Mohand-ou-Mhand, Youcef Oulefki, Bachir Amellah… Un héritage extraordinaire apparait au grand jour. Il s’ajoute, pour ce qui le concerne, à celui de Victor Hugo ou de Joachim du Bellay, ou plus loin encore d’Homère, d’Esiode, de Sophocle, d’Eshylle ou d’Euripide.
Mais observant la démarche générale de Mouloud Mammeri, on ne peut guère s’empêcher de penser à ce que furent les œuvres, avant lui, de Belkacem Ben Sédira ou de Si Amar ou Saïd Boulifa. Plus près de nous (et de lui), on pense également à Jean Amrouche qui fut de sept ans son aîné ou à Mouloud Féraoun de quatre ans son aîné également et qui fut, comme lui, de cette générations d’écrivains francophones qui ont incarné, notamment, la naissance du roman algérien d’expression française.
Cette histoire raconte les héritages multiples et parfois, et a priori, antagonistes, qui feront entrer Mammeri, comme l’ensemble des élites indigènes de son époque, dans le monde de la contradiction. L’héritage des siens, d’une culture dominée et en voie d’extinction ; et le privilège de l’accès à la culture de l’Autre, du dominant, au plus haut niveau, à ses outils également. L’amour des lettres classiques, de la littérature française, mais l’attachement au legs familial des Imusnawen, qui ont gardé jalousement une langue et une culture pourtant mises à l’épreuves depuis si longtemps. Le choix en somme entre se trahir lui-même à travers la trahison des siens, ou trahir l’héritage de l’Autre, de celui qui lui a, malgré tout, permis de s’élever dans la société coloniale.
Pour ce qui est de la situation de l’Algérie indépendante et le positionnement de Mammeri alors face à un pouvoir autoritaire, on peut dire que la publication de « Poèmes kabyles anciens » en 1980 a été une véritable déflagration. Cette œuvre donne la preuve absolue que le choix exclusif de l’arabo-islamisme était une erreur du pouvoir en Algérie depuis l’indépendance. Pire une poursuite de la colonisation culturelle par d’autres moyens.
De ce côté-là, ce même pouvoir ne s’y trompa guère : tel un criminel dont le forfait éclate au grand jour après une enquête longue et minutieuse, il décida d’annuler la fameuse conférence de Mouloud Mammeri en 1980 à l’université de Tizi-Ouzou.
Mais le peuple de Kabylie ne s’y trompa guère davantage, Il se révolta comme il ne le fit jamais depuis l’indépendance politique de l’Algérie.
Vivre tant bien que mal sa contradiction ou œuvrer à l’ « éveil » des autres ?
Dans un hommage qu’a rendu Radio-France à Jean Amrouche en juin 1963, on entend la voix de Léopold Sédar Senghor, répondant au poète Armand Guibert, et se joignant à ce que ressentait profondément Amrouche : « Etant (Amrouche comme lui) dans une situation de contradiction, nous sommes obligés de dépasser cette contradiction […] en intégrant les deux éléments du réel l’un dans l’autre et dans nous-mêmes ». Je crois que dans ce court entretien, Armand Guibert « classait » Amrouche dans la catégorie des « éveilleurs » au sens du poète lituanien Czeslaw Milosz.
La poésie apparaît comme le dénominateur commun de ce moment exceptionnel de radio : les mots du poète (Senghor) devenu président du Sénégal résonnent avec ceux du poète qu’était profondément Amrouche, jusqu’à la référence au poète lituanien…Cette harmonie qui frappe, ces mots de Senghor, correspondent en tous points à ce que nous pourrions dire de l’âme de poète, de l’héritier de la poésie kabyle ancienne qu’est Mouloud Mammeri.
L’ « éveilleur » Mammeri a voulu dépasser ses contradictions et il s’est largement inspiré pour cela de ses héritages multiples et revendiqués : les lettres classiques françaises, l’anthropologie, la Tamusni, notamment le legs des poètes Kabyles anciens, en retournant à leurs textes, en les cherchant, en les traduisant, en les exhumant et en les valorisant. Car il valorisa ainsi d’autres « éveilleurs » plus anciens et s’inscrivit ainsi totalement dans leur lignée. Dans ses travaux d’ethnologie et d’anthropologie, il utilisa un outil dont sans doute usa à mauvais escient le milieu universitaire colonial, pour faire de l’« ethnologie bien faite », celle qui tient lieu de « psychanalyse sociale, dès lors que présent et passé sont imbriqués ». En littérature, c’est la langue française qu’il aimait qui lui permit d’exprimer une singularité, de participer au mouvement révolutionnaire des écrivains algériens francophones des années 1950 qui ont osé parlé du fond de leurs réalités. En linguistique enfin, il travailla à la formalisation écrite et aux structures grammaticales ainsi qu’au vocabulaire du berbère…. Il porta aussi haut et fort des valeurs que l’Algérie indépendante, qui sortait pourtant de la domination, a vite abandonnées.
Mammeri s’est senti investi (malgré lui en quelque sorte) d’une mission avant toute chose vis-à-vis de lui-même, sur un chemin long et escarpé. Un voyage initiatique où il a appris progressivement qui il était, y compris dans le miroir déformant du dominant, où était sa place dans le « Cosmos » tel Ulysse. Un véritable « Odyssée de la réappropriation », selon les mots de Pierre Bourdieu dans un hommage qui a succédé à sa disparition. Puis, après ce retour à lui-même, la place de l’Autre, les siens d’abord dans un élan de transmission, ensuite le monde, les peuples colonisés jusqu’à l’Universel : « […] à vrai dire l’expérience (de la réappropriation donc), loin d’être singulière, intéresse une grande partie du monde, en particulier le monde récemment décolonisé … ».
Il fut loin de se contenter d’une carrière d’enseignant et d’écrivain à succès qu’il pouvait mener confortablement, avant et après l’indépendance. Son choix de vie fut tout autre, même s’il en paya un prix fort par les fortes critiques qu’il subit dans le milieu des intellectuels « organiques » nationalistes depuis la parution de son premier roman « La colline oubliée », en 1952, puis un inacceptable isolement ponctué d’accusations abjectes, notamment de collusion intellectuelle avec la colonisation dans l’Algérie indépendante.
La transmission
C’est un fait sociologiquement établi : la transmission est faite de continuités ou de ruptures. Elle s’ouvre toujours sur une trajectoire à la fois libre et déterminée. Car le changement se fait dans la continuité et le sujet construit son devenir dans un champ de possibles que l’histoire oriente. Dans le cas de Mouloud Mammeri, l’œuvre de transmission active, consciente et organisée, à laquelle il s’est livrée, concerne essentiellement une langue, une culture, une civilisation qui étaient littéralement en voie d’extinction, si bien que l’acte banal de transmission même était menacé et il fallait une force considérable pour le maintenir vivant. On peut dire par conséquent que ce processus de transmission ne fut pas de l’ordre de la spontanéité, car Mammeri n’a pas fait que transmettre ce qu’on lui a légué. Il a usé de ses héritages multiples pour fabriquer un nouveau savoir, et ce dès le plus jeune âge. Il a fait des recherches acharnées en dehors des lieux qu’il a connus, a fait avancer la connaissance en exhumant ce qui était encore inconnu, enfoui.
De même, ce processus de transmission ne s’est pas contenté d’un terrain restreint mais s’est ouvert au monde.
C’est ainsi que Mammeri devient, par choix, un passeur ; car le concept (complexe) de transmission évoque l’idée de passage. Mouloud Mammeri est donc avant tout un passeur : « il était temps de happer les dernières voix, avant que la mort ne les happe », écrivait-il.
Selon l’anthropologue Tassadit Yacine, il « avait cette détermination qui marquait une rupture, qui signifiait par là-même une mise en question de l’ordre politique […] mais aussi une contestation de l’ordre social puisque les Algériens, les Kabyles ont malgré eux intériorisé les valeurs et la culture dominante et en arrivent même à oublier leur propre histoire et les soubassements de leur personnalité. »
La transmission pour Mammeri fut un sport de combat, une œuvre restée inachevée.
Alors que son héritage, ou ses divers héritages, relèvent d’une continuité dont il a su profiter à son avantage, sa transmission relève de la rupture, de la contestation de l’ordre établi et d’une remise en question des pouvoirs politiques (la France coloniale, puis l’Algérie indépendante).
De la littérature à l’anthropologie, en passant par le théâtre, la poésie, la linguistique…Mouloud Mammeri illustre, met en valeur et défend la langue et la culture amazighes, enseigne le berbère à l’université d’Alger d’octobre 1965 à juin 1972, une tolérance du régime qui prit fin mais qui marqua une génération d’élèves… Il donne des conférences, publie livres et articles, contes pour enfants, précis de grammaire berbère, dictionnaires, divers traités de littérature berbère avec d’importantes traductions du berbère au français … De plus, Mammeri, avec l’attachement qui le caractérise à la Kabylie et son village natal, ouvre son travail aux berbères hors de la Kabylie et de l’Algérie et a , dans le fond, l’ambition d’ ouvrir son travail, la culture berbère, au monde.
Une culture qu’il ne veut pas figée, mais vivante. Il accuse même le système colonial d’avoir été l’artisan de cette tentative de folklorisation de sa culture, dans l’objectif de l’aliéner, de la dominer, de la tuer : « Le postulat d’une tradition immuable, concrètement définissable de l’intérieur, intervient comme un élément d’une stratégie plus ou moins consciente, et comme notion sécurisante. L’autre rendu transparent par l’analyse, et aussi fossilisé, condamné à l’immobilité des choses, devient par-là manipulable, il cesse d’être imprévisible. »
Cette transmission résonne en nous aujourd’hui, c’est celle d’un homme qui, à travers la langue et la culture amazighes, a lutté pour l’humanité, pour la culture humaine, contre l’exclusion et l’ensevelissement de trésors dont il a entendu l’écho résonner en lui dès l’enfance. Il a lutté contre des ordres politiques avides de contrôler, d’asphyxier, de chosifier, de tuer in fine… Il lutta pour la vie et pour l’ouverture, contre toute forme d’enfermement. C’est un homme, contrairement à ce que pense de lui certains de ses admirateurs même, totalement tourné vers l’autre, vers l’avenir, vers la libération des femmes et des hommes des chaines de l’aliénation, car qu’est qu’une culture, comme il le dit lui-même, sinon un instrument de libération ?
*Hafid ADNANI est né en Algérie. Journaliste et cadre supérieur de l’éducation nationale, il est également doctorant en anthropologie au Laboratoire d’Anthropologie sociale du Collège de France.
A lire : Avec Mouloud Mammeri, textes de Tassadit Yacine recueillis et annotés par Hafid ADNANI. Editions Non-Lieu. L’édition algérienne (Chez Koukou) vient de paraître avec le titre « La face cachée de Mouloud Mammeri ».
- CRB - PAC : Une place de dauphin en jeu pour le Chabab
- Mikhail Bogdanov reçu par Tebboune : L’Algérie et la Russie consolident leurs relations
- Après les viandes et les poissons : Y-a-t-il une spéculation sur les prix du café ?
- CSC - Le rêve grandissant des Sanafir en coupe : L’appétit vient en mangeant
- CSC - Le rêve grandissant des Sanafir en coupe : L’appétit vient en mangeant
- ESS : Prêts pour la JSS
- Suite à la riposte iranienne: La Malaisie appelle à une désescalade au Moyen-Orient
- Appel à participation au colloque sur les transformations du théâtre en Afrique à l’ère des médias
- Education nationale : Les orientations de Belabed pour le 3e trimestre
- Rumeurs sur une révision de l’allocation chômage: La Présidence dément
- USMA - Après sa brillante qualification pour les ¼ finale : Cap sur l’US Biskra
- ESS : L’Entente met le paquet pour Chetti et Draoui
Infos régionales

Annuaire des sites algériens
Autres sites
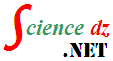
Le site des sciences en Algérie
Vous cherchez un emploi? Essayer la recherche d'emploi en Algérie
 Babalweb Annonces
Babalweb AnnoncesPetites annonces gratuites
