Mohamed Mebtoul. Sociologue de la santé et auteur
«La pandémie interroge en profondeur la société et le fonctionnement du politique»

Dans l’entretien accordé à El Watan, Mohamed Mebtoulrevient sur son essai consacré à la Covid-19. Sociologue de la santé, l’auteur explique que la pandémie «ne se réduit pas aux sciences du vivant. Elle déstabilise et interroge en profondeur la société et le fonctionnement du politique défini ici par la façon dont celle-ci est instituée». Mohamed Mebtoul est professeur de sociologie à l’université d’Oran 2 et chercheur associé au GRAS (unité de recherche en sciences sociales et santé).
Vous venez de publier un essai intitulé Covid-19, La mise à nu du politique, Effets pervers sur la société (Ed. Koukou). Dans l’introduction de votre ouvrage, vous précisez l’objectif de votre étude : «Comprendre finement la pandémie Covid-19 et ses effets pervers et inédits sur la société et le fonctionnement du politique.» Vous mettez en avant la nécessité de mobiliser les connaissances en sciences sociales pour «dévoiler les impensés que les différents pouvoirs et les acteurs dominants des institutions sanitaires ne souhaitent pas entendre». En quoi consiste la recherche dans ce domaine particulier (SC de la santé), notamment dans un contexte de crise sanitaire inédit ?La pandémie Covid-19 ne se réduit pas aux sciences du vivant. Elle déstabilise et interroge en profondeur la société et le fonctionnement du politique défini ici par la façon dont celle-ci est instituée (Mouffe, 2016).Tout désordre biologique conduit nécessairement à de profondes perturbations sociales et politiques. L’interpénétration entre le biologique, le social et le politique semble importante pour comprendre la complexité et la globalité de la crise sociosanitaire. Le développement de la biologie est impulsé par le politique, «pointant l’entrée de la vie et de la santé dans les stratégies politiques» (Vailly et al., 2011), attestant de l’emprise du pouvoir sur nos corps respectifs.
Les Sciences sociales tentent donc de produire des connaissances autonomes qui permettent de prendre de la distance par rapport au mal en soi, mettant en perspective des notions trop évidentes, comme le risque, la prévention sociosanitaire, les injustices sociales, le fonctionnement du système de soins, etc. Il semble difficile de donner une définition absolue et irrémédiable au risque dont le terme est polysémique, pluriel, différent selon la façon dont nous l’envisageons en référence aux trajectoires sociales respectives des uns et des autres. Loin de concerner uniquement les comportements en soi, comme si nous étions des électrons libres, le risque s’incruste profondément dans le fonctionnement de la société. Ce que le sociologue allemand Ulrich Beck (1986) nomme la «société du risque» permet d’indiquer les dangers pernicieux, quotidiens au cœur du système capitaliste, dévoilant l’absence de toute anticipation par les pouvoirs. Derrière la façade du progrès économique et social, surgissent pourtant des risques majeurs pour nos vies à la fois sociales, psychiques politiques et biologiques. Les sciences sociales sont armées pour questionner de façon critique la collusion entre vie biologique et expérience sociohistorique des personnes en décrivant de l’intérieur leur «inégale valeur de vie» (Fassin, 2020), radicalisée avec la crise socio-sanitaire, mettant à nu les profondes injustices sociales. La pandémie a été appréhendée à partir de sa dimension morale et moralisante, occultant l’importance de l’historiciser, de la mettre en perspective, de montrer ses multiples imbrications avec le politique. Celui-ci est très embarrassé dans la gestion des crises successives qui ont rarement fait l’objet de préparation et d’anticipation conséquentes (Keck, 2021). Les pouvoirs sont contraints de répondre précipitamment à la pandémie qui a cette force de tout bouleverser, laissant les Etats et les sociétés dans l’incertitude, c’est-à-dire l’inquiétude, la perplexité et une prévention strictement de conjoncture faiblement enracinée et imaginée dans la société. Les discours du politique et des médias ne peuvent que reproduire et diffuser les normes de prévention, considérant «faussement» la société comme une cruche vide qu’il suffit mécaniquement de remplir de connaissances et d’attitudes pour lutter contre la crise, réduite à sa dimension strictement sanitaire (mise en œuvre des protocoles préventifs). Le refus du politique de prendre en considération la complexité et la globalité de la crise aboutit en réalité à chosifier la société. Elle est refoulée à la marge. Elle n’est pas reconnue comme un acteur collectif pouvant construire un champ du possible, en se mobilisant pour accéder à une transformation sociopolitique par le bas.
Des mesures sanitaires ont été mises en place par les pouvoirs publics pour endiguer la propagation de la pandémie (confinement, mesures barrières, etc.). Comment ces décisions se sont-elles imposées aux gestionnaires de la crise ?Les normes sanitaires recommandées par les organismes internationaux, notamment l’OMS, ont été en grande partie à l’origine des décisions prises par les pouvoirs publics. Des nuances dans l’application des normes de prévention ont été déployées selon l’histoire des sociétés, le fonctionnement et la nature des différents pouvoirs, la prégnance ou non de débats contradictoires et des controverses publiques, etc. On notera tout de même la prédominance d’une gestion sécuritaire et patriarcale, n’hésitant pas à confiner la démocratie déjà mal en point dans de nombreux pays qui prétendent en avoir le monopole. En Algérie, on est dans la continuité concernant la forte sous-analyse de la société. La gestion de la pandémie montre de nouveau les limites des chiffres peu rigoureux et aléatoires annoncés par les autorités sanitaires. Ils dévoilent à la fois l’irréalisme sanitaire et l’opacité des données qui sont loin de correspondre à la quotidienneté vécue par les personnes : les consultations dans le secteur privé des soins, l’automédication persistante chez le pharmacien, les malades asymptomatiques ne sont pas comptabilisés dans la plateforme du ministère de la Santé. Autant d’éléments qui mettent à nu la fragilité du système de santé. Son fonctionnement ne peut être qu’aléatoire face au peu de crédit accordé à la compréhension fine de la société qui s’impose dans toute politique publique. Enfin, l’éclatement des territoires professionnels conduit à l’absence de toute régulation contractualisée du système de soins, renforçant la méfiance des populations.
On a assisté ces derniers mois à la remise en cause de la «parole scientifique». Comment expliquez-vous la prégnance de ce phénomène ?Il faut rappeler que la crise socio-sanitaire a révélé les incertitudes scientifiques, le bricolage prégnant dans la recherche scientifique qui est aussi une pratique sociale bien mise en évidence par la sociologie des sciences (Latour, 1987) et enfin les multiples cacophonies cognitives qui ont marqué les différents espaces scientifiques. Il est incontestable que l’intérêt médiatique pour la science en liaison avec la pandémie a favorisé les controverses publiques, qui sont le fait des personnes détentrices d’un capital culturel et scientifique élevé (Ward, Peretti-Watel, 2020). Cet imaginaire produit sur la science, objet de débats contradictoires, de questionnements critiques, n’est pas de l’ordre d’un refus de la science en soi, mais de ses usages pluriels loin d’être neutres et ne répondant pas toujours aux attentes de la société. Malgré les progrès considérables de la science, la «chaîne de production des savoirs s’est industrialisée» (Laval, 2009) pour être au service d’un marché mondialisé, faisant peu cas des contraintes sociétales liées à l’alimentation, au réchauffement climatique, aux risques environnementaux, etc. Les connivences scientifiques avec l’ordre économique dominant ne sont pas rares. Nous le montrons dans la dernière partie de notre ouvrage. Elles contribuent à l’accroissement des profits des sociétés multinationales. «La science devient de plus en plus nécessaires, mais de moins en moins suffisante à l’élaboration d’une définition socialement établie de la vérité» (Beck, 1986). La pandémie aura dévoilé au contraire l’impératif de plus de science autonome, plus d’interventions sur le plan financier de l’Etat dans le développement de la recherche, dans le but de prendre en charge de façon plus efficace les questions de santé publique, a contrario du retrait scientifique actuel, comme le souligne l’économiste de la santé, Nathalie Coutinet (2021). Elle montre bien que l’industrie pharmaceutique dépense plus en marketing – y compris le lobbying – qu’en recherche développement, donnant ainsi la priorité à un objectif financier en servant le plus gros dividende à ses actionnaires (Le Monde, 7 et 8 février 2021).
Vous précisez dans votre essai que la gestion de la crise a provoqué le « refoulement » de la société à la marge, « lui signifiant de façon brutale et maladroite l’impératif d’obéissance et de soumission aux normes médicales ». Une persistante « crise de confiance » s’est même installée empêchant parfois le respect des mesures décidées par les autorités. Une explication ?Le discours unilatéral, moral et général qui consiste à prétendre « sensibiliser » les populations par la médiation des médias publics et privés, pour le respect des mesures préventives dans le but de réduire la contamination du virus, en étant silencieux sur leur diversité sociale et culturelle, leurs multiples vulnérabilités et ce qu’ils pensent réellement de la crise globale, a eu un effet inverse. Le discours moraliseur à souhait n’a pas produit les effets escomptés. Il a au contraire été considéré comme porteur de violence symbolique, dévoilant la rupture avec les représentations sociales des personnes. L’environnement social et physique immédiat a des liens forts avec le mode de perception et de croyances des gens. Si l’ordre de vie est caractérisé par la saleté persistante des quartiers, le faible ancrage des pouvoirs locaux dans la « cité », les éclatements institutionnels entre les différents ministères, la crise des médiations sociosanitaires, des informations sanitaires peu crédibles, le discours médical ne peut être que « prisonnier » d’un ordre sociétal fabriqué par le politique. Notre enquête auprès de la population (deuxième partie de l’ouvrage) montre bien que l’information sanitaire n’est pas ignorée, mais toujours interprétée, sélectionnée, filtrée selon la confiance accordée aux différents émetteurs. La captation hiérarchisée de l’information redonne de la pertinence en premier lieu aux réseaux familiaux et sociaux. La confiance est ici centrale parce qu’il s’agit de produire une croyance, une certitude qui permet l’adhésion à des habitudes sanitaires incorporées dans le corps social de la personne. Il est impossible qu’un système de représentations puisse se transformer du jour au lendemain, s’attachant au passé, construit durant toute une trajectoire de vie. Il permet à la personne de baliser ses repères identitaires en intégrant les groupes sociaux qui lui sont les plus proches en termes de représentations sociales. L’ancrage des anciennes représentations sociales recouvre une puissance symbolique d’autant plus marquée dans une société dominée par la négation de toute citoyenneté définie comme un mode d’engagement dans la société.
Selon vous, la « prévention socio-sanitaire » n’a jamais été prise au sérieux par le politique. Un commentaire ?On peut dater les transformations rapides et violentes du système de soins à partir des années 1980, marqué d’une part par le renforcement du modèle curatif dominé par la greffe précipitée d’un hospitalisme fragile, doté de faibles moyens techniques et humains, à l’origine d’une errance sociale et thérapeutique des patients anonymes contraints de recourir aux hôpitaux des trois grandes villes (Alger, Oran, Constantine). D’autre part, l’accentuation de la marchandisation des soins dévoilant un champ thérapeutique qui n’est pas indemne de la violence de l’argent, de l’usage intense des techniques médicales au détriment d’une écoute attentive des patients, un accroissement important de l’automédication auprès des pharmaciens, encore observée durant la pandémie. Médicaments, argent, pouvoir centralisé focalisé sur le strict corps organique, intériorisés aussi par la société, dévoilant, non seulement de fortes inégalités sociales de santé, des injonctions par le haut, en rupture avec les attentes précises de la population. Elles se traduisent par une médicalisation extrême du tissu social, obligeant les patients à multiplier les recours thérapeutiques, à la quête de sens de soins, en l’absence d’un médecin de famille. Autant d’éléments importants qui ne favorisent pas une prévention sociosanitaire de proximité avec la population, pouvant permettre une autre appréhension de la crise sociosanitaire par la population. Dans notre enquête, le mot prévention sociosanitaire est appréhendé par la population de façon interactive, ne se limitant pas à la diffusion mécanique et routinière des normes sanitaires. Nos interlocuteurs n’hésitent pas à formuler des propositions : création d’équipes composées de médecins et de personnes qui ont la confiance de la population pour s’engager dans un modèle de prévention contractuel centré sur la concertation, la persuasion, et le débat novateur, autant d’éléments relationnels importants pour donner sens à une attente forte de la population : « qu’ils viennent discuter avec nous ».
Vous mettez l’accent sur « démocratie sanitaire » qui devra marquer le fonctionnement du système de soins. Qu’en est-il ?
La démocratie sanitaire est l’antithèse du fonctionnement actuel du système de soins. Celui-ci a montré ses limites, obligeant les médecins à se désaffilier de leur espace professionnel, en l’occurrence l’hôpital. Il impose toujours par le haut des règles de fonctionnement qui intègrent une gestion verticale et administrée de la structure de soins. Il produit du flou socio-organisationnel en l’absence de toute évaluation collective et rigoureuse de ses activités. Il semble donc important d’opérer une critique rigoureuse de la notion de système de santé publique qui suppose au contraire un ancrage socialement reconnu de celui-ci dans et par la société. La bureaucratie sanitaire centralisée est dans l’ambiguïté et la confusion entre d’une part la priorité donnée à la proximité géographique (une structure de soins localisée dans un quartier donné) et d’autre part, la proximité sociale qui est de l’ordre du non-dit, devant permettre la reconnaissance publique et donc politique du patient-usager lui donnant la possibilité d’exercer ses droits dans l’espace de soins. Trente ans de travail d’enquête dans les différentes structures de soins en Algérie, nous conduisent modestement à indiquer que la santé citoyenne est encore de l’ordre de l’absence. Elle peut être caractérisée par la prégnance d’une triple dignité à la fois sanitaire, politique et professionnelle, seule à même d’accéder à un pacte sociosanitaire entre les différents acteurs de la santé. La démocratie sanitaire est indissociable de l’appropriation publique et collective du système de soins, en permettant à ses différents acteurs de donner sens aux mots de liberté et d’égalité entre les différents patients quelque soient leurs conditions sociales, leur donnant la possibilité de s’engager activement en participant à son fonctionnement au quotidien. La santé citoyenneté est donc antinomique avec la concentration du pouvoir par le haut. Elle suppose au contraire la production autonome et forte du local permettant de donner un sens pertinent à la régionalisation sanitaire qui suppose un transfert du réel du pouvoir vers les instances locales reconnues par les populations.
N. Id.
- CRB - PAC : Une place de dauphin en jeu pour le Chabab
- Mikhail Bogdanov reçu par Tebboune : L’Algérie et la Russie consolident leurs relations
- Après les viandes et les poissons : Y-a-t-il une spéculation sur les prix du café ?
- CSC - Le rêve grandissant des Sanafir en coupe : L’appétit vient en mangeant
- CSC - Le rêve grandissant des Sanafir en coupe : L’appétit vient en mangeant
- ESS : Prêts pour la JSS
- Suite à la riposte iranienne: La Malaisie appelle à une désescalade au Moyen-Orient
- Appel à participation au colloque sur les transformations du théâtre en Afrique à l’ère des médias
- Education nationale : Les orientations de Belabed pour le 3e trimestre
- Rumeurs sur une révision de l’allocation chômage: La Présidence dément
- USMA - Après sa brillante qualification pour les ¼ finale : Cap sur l’US Biskra
- ESS : L’Entente met le paquet pour Chetti et Draoui
Infos régionales

Annuaire des sites algériens
Autres sites
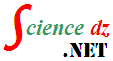
Le site des sciences en Algérie
Vous cherchez un emploi? Essayer la recherche d'emploi en Algérie
 Babalweb Annonces
Babalweb AnnoncesPetites annonces gratuites
